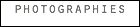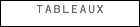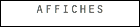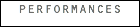JAN VAN WOENSEL
jan van woensel /2009
it’s right outside your door
De la peur et du jeu dans le travail d’Alain Declercq.
À travers ses photos, vidéos, performances et installations, Alain Declercq scrute le fonctionnement de la peur et du danger. Il explore la manière dont ces éléments peuvent impacter, de façon temporaire ou durable, sur nos sociétés et sur notre conscience tant individuelle que collective. Dans ses entreprises artistiques, l’artiste en tant que provocateur est au centre du dispositif. Depuis quelques années, Declercq a réussi à incarner des figures telles que l’antihéros, l’agent secret, l’espion, l’escapologiste et le sniper. Ce sont tous des individus qui vivent à l’ombre de la société, qui préparent leur prochain coup en ayant soin de passer inaperçu dans l’environnement où ils évoluent. Leur existence clandestine est totalement consacrée à l’exécution sans faute d’un ou de plusieurs projets. Une fois le projet achevé, ils retournent à leur qg pour en livrer le compte-rendu compréhensif avant de se voir attribuer une nouvelle mission – mission parfois violente.
Souvent, il s’agit de résoudre seul une situation politique ou sociale qui a trop duré. Le sniper, par exemple, possède les capacités et la motivation de descendre un personnage clé, comme un politicien de premier plan, avec une seule balle. Il quitte alors discrètement le lieu du crime avant même que les enquêteurs et les brigades spéciales hautement formées de la police ne puissent déterminer de quel endroit le coup de fusil a été tiré. Le résultat immédiat est le chaos. L’intervention du sniper conduit inévitablement à une réorganisation politique ou sociale. Son geste aura donc des effets sociaux, politiques et psychologiques qui dépassent de loin le fait de mettre fin à la vie de la cible. Justifiables ou pas, ses actions en viennent à symboliser un changement radical. Sur le plan artistique, Alain Declercq est fasciné par les actions transgressives et les activités couvertes, et les traduit en œuvres à la fois drôles et relevant de « l’inquiétante étrangeté ». Pour commenter nos sociétés contemporaines hantées par une angoisse accrue face au terrorisme et autres extrémismes mortifères, Declercq crée des œuvres qui exposent et flirtent même avec ces éléments hostiles. Plutôt que d’aborder ces enjeux intenses et sensibles comme le ferait un journaliste, l’artiste s’y prend avec humour et fiction. Prenez par exemple sa série récente de photos prises avec un sténopé. Celles-ci représentent des zones interdites, centres de détention et de correction à New York, des lieux sûrs qui sont conçus pour enfermer des criminels et qui sont protégés par des caméras de surveillance et de lourdes portes blindées. En photographier un, voire, comme le fait Alain Declercq, les photographier tous, ferait vite soupçonner que l’auteur est en train de prévoir une action interdite par la loi. L’artiste agit, donc, en véritable espion, en prenant des photos avec son petit sténopé artisanal tout en se conduisant comme un innocent passant. Mais au lieu de comploter en vue d’une action illégale, Alain Declercq présente ces images comme des œuvres qui documentent ses actions teintées d’espionnage. Les qualités esthétiques de ces photos ainsi que les intentions ambigües dont elles relèvent soulignent les risques encourus pour les prendre.
Dans cette ville plutôt sûre qu’est New York, des messages automatiques, répétés tels des mantras, comme « si vous voyez quelque chose, n’importe quoi, dites-le », ou, « si vous voyez un paquet ou une activité douteux dans un train sur un quai », évoquent la menace et le danger potentiels qui hantent nos trains et nos gares. Même si la ville semble bien plus sûre qu’il y a, mettons, dix ans, le pouvoir tient à ce que chaque individu soit averti du danger potentiel qui le guette à chaque coin de rue. Si le fait de sensibiliser n’est pas forcément mauvais en soi, il
implique de poursuivre un danger invisible, absent. La nypd met l’accent sur un péril imminent, potentiel, mais qui n’existe peut-être pas encore.
Les effets psychologiques déclenchés par les œuvres d’Alain Declercq, et encore plus par les processus inhabituels dont elles procèdent, nous rappellent cette relation déconcertante entre l’absence de danger et cette con-science du danger potentiel systématiquement inculquée par les messages vocaux du nypd. L’artiste lui-même est passé maître dans l’art de semer le doute et le soupçon. Ses instantanés des zones balisées urbaines sont bien des œuvres d’art, mais elles transforment l’artiste en espion ou hors la loi, comploteur d’une évasion ou autre acte illicite. Non seulement Alain Declercq éprouve les frontières du comportement social et moral acceptable, mais il provoque les systèmes autoritaires conçus par des législateurs et régis par les forces de l’ordre. De leur point de vue, les activités de Declercq sont suspectes, sans aucun doute, et très certainement dérangeantes. Tirer avec un fusil sur un B 52 en partance pour une opération militaire en Irak, se faire passer pour un espion en mission au Pentagone ou au World Trade Center, prendre clandestinement des photos des prisons et des centres de correction de la ville, maquiller une véhicule pour en faire une réplique exacte d’un véhicule de police, ou falsifier la signature et l’écriture de quelqu’un d’autre, voilà quelques-unes des activités douteuses menées par cet artiste.
Cependant, dans le monde fantastique et visionnaire de l’art nous fêtons ces actions en tant que projets courageux, œuvres d’art sublimes et choquantes, et constats socio-politiques pertinents. Alain Declercq fait de l’artiste un militant qui semble intangible, qui, derrière le bouclier de l’art, peut sans peine endosser le rôle d’antihéros, agent secret, espion, escapologiste ou sniper. À travers sa pratique, Alain Declercq commente les perturbations psychologiques induites par des lois et des autorités corrompues. Il situe ses projets dans le monde réel, là où le risque est le plus fort.
« C’est là, juste derrière ta porte ! » crie Zack de la Rocha, chanteur de Rage Against the Machine, en nous signalant le fait que sera bientôt révélé la vérité horrible cachée tant bien que mal par la propagande abrutissante des gouvernements. Tout comme ces paroles de Rage, les œuvres d’Alain Declercq nous rappellent notre assujettissement à un pouvoir répressif. Son travail propose des aperçus merveilleux à travers ses infiltrations audacieuses et ses activités subversives du pouvoir. Son arme la plus forte est la création ; l’art est ce qui le motive ; ses intentions sont ambivalentes.
Jan Van Woensel vit à New York, il est curator, critique
d’art indépendant et musicien dans le groupe Tithonus. Il est
fondateur et rédacteur en chef du New York Magazine
of Contemporary Art and Theory. Il a enseigné au California
College of the Arts à San Francisco et à la New York
University. En 2008, il a bénéficié du programme international
de résidence à l’Otis College of Art and Design de Los Angeles.
La NYC Bloomberg Curatorial Fellowship at Art in
General and Bloomberg LP lui a décerné un prix en 2007.
GÉRARD WAJCMAN
NICOLE BRENEZ
Florise Pagès
BÉATRICE GROSS
JEANNE SUSPLUGAS
NICOLE BRENEZ
Michel NURIDSANY
gérard wajcman /2009
portrait de l’artiste en persée
1.
« Tout peintre est Persée ». On prête cette phrase à Caravage, forcément. Elle dit en entier : « Tout tableau est une tête de Méduse, tout peintre est Persée. »
Ceci n’est pas une formule précieuse, contournée, une image poétique, le portrait littéraire, mythologique et héroïsé, de l’artiste. Sous ses dehors en dentelles XVIIe, c’est la définition brutale d’un art de combat. Pensée radicale, loin de tout lyrisme, dure et tranchante comme l’acier, d’une précision et d’une profondeur stu-péfiantes, elle ne vaut pas simplement pour les artistes du temps jadis, elle les concerne tous, à tous les âges, y compris aujourd’hui. Surtout aujourd’hui. Ainsi on dira aujourd’hui qu’Alain Declercq
est Persée.
2.
Mieux que les concerner, la formule de Caravage con-voque les artistes, elle les appelle, ou les rappelle à l’ordre des exigences de leur art. Chaque œuvre accomplirait le geste d’exposer la tête tranchée de la Gorgone Méduse. Bien sûr, dans l’affirmation caravagesque chacun entend un impératif, même une injonction : tout tableau devrait, tout peintre doit. La proposition universelle « tout pein-tre est Persée » témoigne peut-être d’une extrême générosité de Caravage envers la communauté de ses camarades artistes, qui se trouvent ainsi collectivement et gracieusement élevés à la dignité de héros, mais elle contient aussi pour eux, par l’assignation d’un idéal, un danger qui les menace dans leur être, en obligeant chacun à s’y mesurer : et s’il ne parvenait pas à s’y reconnaître, s’il devait se juger inégal à la figure du héros, ne devrait-il pas du coup abdiquer toute prétention d’artiste, son identité même ?
N’est pas Persée qui veut. Artiste non plus. Il faut immédiatement dégonfler tout le western, l’imaginaire qui se met à mousser dès qu’on parle de héros, il risque d’égarer. Pas d’épopée en vue. L’artiste-Persée est un héros essentiellement discret, et plutôt paisible fina-lement. Pas de bruit et de fureur, ce n’est pas d’une action sublimement dangereuse dont parle Caravage – encore que dans son cas, comme dans celui d’Alain Declercq, l’engagement et le risque physique soient présents dans leur vie d’artiste et leur œuvre. Quoi qu’il en soit, pour être Persée, inutile que l’artiste échange son pinceau contre l’épée courbe d’acier que, dit-on, Hermès offrit au champion d’Athéna. Il n’a nul besoin d’autres armes que celles de son art pour réaliser la mission impossible de ramener la tête de la Gorgone Méduse, le monstre aux cheveux de serpents dont le regard change les hommes en pierre. Si Caravage lui-même a mené une vie tumultueuse, s’il a nuitamment réglé quelques différents au couteau, s’il a connu la prison, s’il a été mêlé à des crimes, le meurtre de Méduse, c’est à coup de pinceau qu’il l’a accompli, dans ses tableaux.
Dans un tableau spécialement, une peinture plutôt, Méduse, datée de 1598, conservée à la Galerie des Offices à Florence. Si on a en tête l’affirmation de l’artiste, cette peinture prend d’un coup valeur de paradigme de tout son art, et, de là, de tout l’art. D’un art qui ne recule pas.
3.
Tuer Méduse est un acte éthique que l’artiste est supposé accomplir dans son art. Ce qui veut dire qu’il est supposé accomplir le meurtre en chaque œuvre, le répéter sans fin, chaque jour. L’artiste est un serial killer. Mais c’est la mort qu’il tue chaque fois.
4.
Pendant un moment, je me suis demandé pourquoi la série Hidden d’Alain Declecq (2008) était faite d’images rondes. Je savais qu’il avait fait usage d’un appareil photo bricolé en camera obscura élémentaire, avec son trou circulaire obligé en guise d’objectif (il est de l’essence du trou d’être rond), mais cela ne me suffisait pas. L’explication par la technique ne pouvait satisfaire. L’idée de la forme de l’œil serait déjà plus intéressante. Chaque photographie serait comme un œil caché observant par un trou (les bords noirs de l’image ne sont là que pour le délimiter, indiquer sa présence). Le regard se glissant par un trou en zone interdite. Pourquoi pas.
Ceci n’empêchant pas cela, il n’en reste pas moins que, même si l’intention de l’artiste n’est ni exprimée ni explicite à cet égard, s’il n’y fait nulle part référence, si rien n’indique qu’il y a même songé, je n’arrive pas à ne pas mettre mentalement les images rondes de Hidden à côté de la Méduse du Caravage, peinte, comme on sait, sur un bouclier rond (de 55 cm environ de diamètre, chaque Hidden Camera Obscura étant au format 50 x 50 – c’est amusant, mais ne faisons pas toute une histoire des ressemblances formelles, pas besoin de faire des images rondes comme Caravage pour être Persée).
Commandé par le cardinal Francesco Maria Del Monte, alors protecteur du peintre, le bouclier, en bois de peuplier, venait compléter une armure de parade qui devait être offerte au cardinal grand-duc de Toscane, Ferdinando de Medici, Ferdinand de Médicis. D’où une précision à laquelle on devrait veiller dans la façon de dire, qui n’est pas sans utilité, à savoir que ce qui est accroché aujourd’hui aux Offices de Florence, ce n’est pas un tableau de Caravage, mais le bouclier, peint par Caravage, d’un homme de pouvoir, maître d’une puissante cité d’Italie et prince de l’Eglise. L’objet semble souvent s’oublier derrière l’image, réduit à l’état de simple support. Or on ne devrait pas tenir pour rien, si on veut saisir tout l’enjeu de la peinture, qu’il s’agit d’un « véritable » bouclier de parade, c’est-à-dire que c’est sur un pur symbole du pouvoir, de la puissance, que Caravage a peint l’image la plus puissante, le Gorgoneion, la tête de la Gorgone Méduse dont la vue est supposée terrifier et pétrifier des armées entières. On se souvient d’ailleurs que dans le récit du mythe, Persée, enfourchant Pégase, rapporte vite fait la tête dans un sac à Athéna, déesse de la guerre, de la pensée et des armes, et que celle-ci va la placer au centre de son égide. C’est ainsi qu’à l’image de la déesse son geste sera répété dans l’histoire par les plus grands maîtres de guerre, et que, par exemple, Louis XIV, éblouissant soleil, portera la figure de Méduse sur ses armes.
Représenter Méduse sur un bouclier de parade, c’est accomplir un acte politique. Dire « Tout tableau est une tête de Méduse, tout peintre est Persée », c’est appeler les regards sur l’enjeu de pouvoir de l’œuvre d’art. Méduse a « la mort dans les yeux ». Elle a donc le pouvoir dans les yeux. Ainsi, offrir la tête de Méduse à une déesse ou à un prince, c’est remettre entre leurs mains plus qu’un symbole, c’est leur faire don du regard comme puissance absolue. Le maître du Gorgoneion sera maître du monde, parce qu’il sera Maître de la Mort.
C’est pourquoi Caravage a soigneusement veillé à peindre Méduse les yeux tournés, le regard de biais, et non de face comme son pouvoir pour s’exercer l’exige, et comme la tradition l’impose (Méduse était chez les Grecs le seul visage représenté de face). Nul touriste, qu’on sache, n’a jamais été transformé en statue de pierre en passant devant cette peinture aux Offices à Florence.
5.
Caravage a coupé la tête de Méduse, il a coupé en même temps les effets meurtriers de son regard. Comme le Persée de Cellini à Florence, statue de pierre dressée dans la Loggia dei Lanzi, face au palais de la Seigneurie, l’artiste brandit la tête ensanglantée de Méduse, il exhibe la figure de la puissance par le regard, mais ce regard est, par lui, désactivé, neutralisé. En coupant la tête de Méduse, c’est en vérité le peintre qui prend ainsi lui-même le pouvoir sur son regard, le mettant à distance. « Éloigne le monstre que tu tiens », c’est ce que chez Ovide on demande à Persée triomphant (Les Métamorphoses, livre v, 216-218).
Le peintre a accompli le geste de Persée, mais il faut mesurer qu’il l’a accompli entièrement, c’est-à-dire que du héros il a aussi pris la ruse, ruse nécessaire, vitale, celle qui, dans ce combat mortel plus qu’incertain, lui a permis, grâce à un jeu habile de miroir, de regard indirect et d’image virtuelle, de garder le monstre à distance, de ne jamais voir la Gorgone de face, de ne pas croiser son regard. Par la ruse du miroir, il a pu tenir le monstre à la fois loin des yeux et proche de sa main, ce qui l’a rendu capable de lui trancher la tête, et de rester en vie.
En somme, on pourrait dire que le génie de Persée revient à avoir su métamorphoser Méduse en image. Si on y songe ce génie-là, finalement, est un génie de peintre. Avec une certaine surprise, grâce à Caravage, on aurait une raison de dire que Persée est peintre. Il était alors dans l’ordre d’attendre du peintre qu’il soit Persée.
Dans son traité De Pictura de 1435, Alberti avait fait de Narcisse l’inventeur de la peinture. Selon Alberti, philosophe, architecte et peintre, tout peintre était Narcisse. Et voilà que Caravage déclare que tout peintre est Persée. À l’artiste mélancolique qui dans un tableau cherche à embrasser le regard aimé perdu, Caravage substitue un peintre combattant, conquérant du regard, qui tranche la tête d’un monstre et lui arrache son masque meurtrier en le plaquant dans une image.
Peintre-Persée, il incarnerait l’alchimie aristotélicienne de l’artiste. « Nous prenons plaisir, écrivait Aristote, à con-templer les images les plus précises des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes
des monstres les plus répugnants et les cadavres. » (La Poétique, 4, 1448, 10-15). On admettra que les temps modernes de la mort de masse, industrielle et technologique, appellent de reprendre à grands frais une telle interrogation sur l’image et l’horreur, le visible et l’invisible, le représentable et l’irreprésentable.
Il me semble que ceci n’a pas échappé à Alain Declercq.
Il se trouve par ailleurs que Méduse, l’œuvre de Caravage, s’est trouvée physiquement violemment projetée dans l’histoire contemporaine. En effet, le 27 mai 1993, un attentat à la bombe a été commis au musée des Offices
de Florence. Il a fait cinq victimes, dont le curateur du musée, et le souffle de l’explosion a sérieusement endommagé 200 œuvres, dont la peinture du Caravage. Lors de l’enquête, on a parlé de la Mafia, mais les auteurs de l’attentat restent inconnus à ce jour. La peinture a dû être longuement restaurée, et n’est redevenue visible que dix ans plus tard, en 2003.
6.
Le visage de Méduse est meurtrier. L’image du visage de Méduse peut être vue sans dommage. Caravage lui a arraché la mort des yeux. Caravage remet au prince la tête de Méduse, mais c’est le peintre qui a conquis le pouvoir du regard, et il le conserve pour lui. Tant pis pour le cardinal grand-duc de Toscane. L’artiste est le maître du regard. Tant pis pour tous les princes du monde, puissants d’hier et d’aujourd’hui.
7.
Arracher la mort des yeux.
C’est ici que surgit le génie du Caravage, du peintre dont Poussin pensait qu’il était « venu au monde pour détruire la peinture », c’est ici que se révèle toute la puissance de son affirmation, le sens aigu et l’enjeu tranchant, essentiel de « Tout peintre est Persée » : comme lui, les artistes ont su conjurer le sort de Méduse.
Ainsi ils sont maîtres du regard, mais pour le devenir ils devront se faire maître de son regard, c’est-à-dire se confronter à l’horreur, conjurer la peur et l’angoisse.
Sera maître du regard celui qui ose affronter le regard qui tue. Pour accomplir son geste, pour triompher, Persée aura donc été Maître de la Terreur. C’est ainsi que les Grecs nommaient Persée : Mestor Phoboio. L’artiste est Mestor Phoboio. Voilà où on arrive. « Tout peintre est Persée » – oui, mais il faut le devenir.
8.
Il n’y a peut-être pas de western à l’horizon, pas d’épopée échevelée, mais il y a quelque chose comme un courage de l’artiste. Pas un courage de gros bras. Il peut se dire dans d’autres mots que ceux de l’héroïsme, tout en suivant au plus près la logique méduséenne : l’artiste a à affronter le regard de l’Autre. D’une façon ou d’une autre. C’est-à-dire que ce peut parfaitement être sans arme, sans la moindre violence, mais non sans force, et il ne peut en faire l’économie.
Il est clair que pour parler d’artiste ici, on n’en est plus à parler d’inspiration, de style ou de talent, même pas de thème, de genre ou d’invention, mais de courage.
Affronter le regard de l’Autre sera un acte de l’artiste, quelle que soit la façon.
Elles peuvent être diverses, mais il me semble qu’elles se répartissent finalement selon deux versants. C’est encore Caravage qui peut ici nous guider. Il se trouve en effet, étrangement – ou peut-être pas si étrangement que ça –, que quasiment au même moment où il peint Méduse, il peint un Narcisse, stupéfiant tableau qui est à la Galleria Nazionale d’Arte Antica à Rome. Qu’on aille y voir, et on y verra très précisément ceci : comment, ici aussi, le jeune garçon, héros tragique de l’amour et figure mythologique du peintre, se penche sur une source aussi profonde que l’Hadès pour y rencontrer un regard, le regard noir de l’absence et comme de la mort. Confrontation mélancolique de deux regards affrontés, où les corps resteront à jamais séparés, malheureux, dans la douleur d’un désir désespéré.
Narcisse et Persée, le sexe et le pouvoir. Persée et Narcisse, ils incarnent au fond les deux grandes passions humaines. Narcisse et Persée, ils impliquent tous les deux d’affronter le regard de l’Autre, chacun à sa façon. Et si, en suivant ce que suggère Caravage, Persée peut, avec Narcisse, être élevé en mythe fondateur de l’art, on pourrait du coup imaginer une grande partition dans l’histoire : il y aurait les artistes dans la voie de Narcisse, et les artistes dans la voie de Persée. Ce serait un jeu amusant à faire. Je crois qu’Alain Declercq a pris résolument la voie Persée. La confrontation des regards est chez lui politique. On pourrait voir ici l’esquisse d’une sorte de principe, à savoir que le style d’une œuvre se définirait non par son genre, ses thèmes ou ses options esthétiques, mais précisément par le choix de l’Autre que l’artiste a entrepris d’affronter. Dans le cas d’Alain Declercq, il semble que ce soit moins celui de l’amour que celui du pouvoir.
9.
La série des Hidden en est un pur exemple. Ici Alain Declercq est Persée en Mestor Phobio. Il expose les images de ce qui n’a pas, en principe, d’image, de ce qui ne doit pas en avoir, de ce qui est interdit. Mais le hidden, le caché dont il est question dans l’affaire est plutôt complexe, assez retors puisque ce que nous font voir ces images n’est pas quelque chose que nous n’aurions pas vu, du nouveau, toujours intéressant, mais ce que nous avons éventuellement pu voir dans les rues de New York, mais sans nous aviser de ce dont il s’agissait, et que, au nom de la défense stratégique, cela était interdit. Alors, en premier lieu, Hidden montre non pas un invisible mais un visible dont on ne voyait pas qu’il était interdit de le rendre visible. Par là, ces images répondent finalement au rôle premier, élémentaire et fondamental, de l’art – montrer.
Ce qui, dans le style de Paul Klee, se dit : « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Après tout, se poster au bord de la route avec un panneau où est écrit « ATTENTION RADAR », comme a pu le faire Alain Declercq, c’est le même geste d’art absolument conforme à la définition de Klee – à condition toutefois qu’il y ait eu réellement un radar à cet endroit, que ce ne soit pas une fiction, une rumeur faisant exister un radar là où il n’y en avait pas.
Mais on peut aller encore au-delà. En dehors des sublimes ponts de New York, qui sont aussi sous le coup d’un interdit assez absurde (bien qu’il soit hors de doute que ce soient des cibles sensibles en cas d’attaque terroriste), quel touriste aurait l’idée d’aller photographier la triste façade de ce qui se révèlera être une prison ? Alain Declercq ne fait aucune révélation visible. Le caché tient dans ceci que les images nous montrent ce que nous ne savions pas devoir ne pas voir. Vous voyez ça, eh ben apprenez que c’est interdit, voilà ce que dit chaque image. Autrement dit, alors qu’il n’y a à proprement parler aucun choc des photos, nous voyons pourtant soudain ces paysages urbains insignifiants d’un autre œil, comme on dit. Ces photographies sont en ce sens le contraire des images sensationnelles journalistiques. Et finalement, même s’agissant des ponts de New York, qui ont été filmés et refilmés sous toutes les coutures depuis toujours, notre regard est néanmoins changé lorsqu’il les découvre dans les photographies de Hidden, en ce qu’ils sont devenus des images interdites. Ce n’est pas la chose en elle-même qui se trouve ainsi révélée, c’est la chose et l’interdit qu’elle recouvre, ou qui la recouvre. Le caché qui est montré dans ces images, c’est le visible lui-même, en ce que le visible lui-même est un cache.
On pourrait dire que ces images sont des images d’alerte, elles sont adressées au regardeur, et leur opération propre est d’ajouter le savoir au voir, en trompant le regard du maître, de déciller nos yeux sur ce que nous voyons.
Banques fédérales, prisons, ponts ou tunnels, rien de vraiment amusant dans ces images. En même temps, je ne peux m’empêcher de penser qu’au fond du projet Hidden, il y a un enfant déluré, celui à qui le papa dit : Surtout ne va pas regarder là, en désignant la porte close de la chambre des parents, et qui ne trouve évidemment rien d’autre à faire dès la nuit suivante que d’aller coller son œil au trou de serrure. L’interdit de voir a cela de précieux et de merveilleux qu’il désigne tout de suite ce qui est intéressant à voir, et qu’il ouvre des carrières de voyeurs. Alain Declercq est un artiste sérieux qui s’occupe de trucs graves, mais c’est quand même, heureusement, un galopin.
Reste qu’il établit ainsi une cartographie inédite de New York, faisant la liste des soixante-dix lieux de la ville interdits aux regards. Il réalise, dans la capitale du XXe siècle vouée aux regards et aux images par sa beauté, la topographie des lieux aveugles de la ville qui ne dort jamais.
Reste que qualifier ces lieux d’aveugles a quelque chose de franchement paradoxal, parce que, pour être interdits aux regards étrangers, ils sont sans doute sous vidéosurveillance intensive, bourrés d’yeux braqués dans toutes les directions, entièrement quadrillés par des caméras qui doivent ne laisser aucun angle mort, de façon à mettre tout passant sous le regard, faisant vraisemblablement de ces blocs les périmètres les plus étroitement surveillés de toute la ville.
Surgissent par là deux autres dimensions du caché dans l’affaire Hidden. Il y a d’abord, quelque part dans la ville, le mur d’écrans où les images des abords de ces lieux interdits apparaissent en temps réel et en continu. Et avec ce mur, le regard des policiers, militaires, techniciens chargés de surveiller les écrans de surveillance, avec l’éternel problème de savoir s’il y a assez d’yeux pour voir tout ce que voient les batteries innombrables de caméras.
Mais face à ce regard de surveillance, l’autre caché dans ces photographies de la série Hidden, c’est simplement le photographe lui-même, dans son geste de photographier. C’est son propre regard qui est caché, ce regard qui pointe dans le trou rond de l’œil des images. La valeur de ces photographies ne tient pas tant à ce qu’elles montrent qu’à ce que, pour les réaliser, le photographe a dû lui-même entrer dans le champ de vision de l’Autre, se mettre sous son regard, sous l’œil des caméras de surveillance. Il faut tout de même supposer que lorsqu’on se rend à la galerie Loevenbruck à Paris voir les soixante-dix photographies réalisées par Alain Declercq à New York, il y a, au même moment, quelque part à New York, dans une archive du nypd où de quelque organisme de défense, soixante-dix séquences vidéo sur lesquelles apparaît un type assez fin d’un mètre quatre-vingt environ, soixante-dix fois le même type assez fin debout avec une boîte carrée bizarre posée sur le sol à ses pieds (c’est ainsi qu’Alain Declercq s’y est pris, le temps d’impressionner le film).
Autrement dit, les images volées de Hidden impliquent que l’artiste a, en personne, affronté l’œil des caméras de surveillance, le regard de l’Autre. Ce n’est pas un fait contingent, c’est une donnée nécessaire, parce que la série de Hidden n’aurait absolument pas le même sens ni la même valeur si les images interdites avaient été prises « virtuellement », en prélevant par exemple, si c’est pensable, l’image de ces lieux sur internet, sur Street View (reste, j’imagine, que l’interdit de l’image vaut aussi pour Google).
Il faut donc penser qu’Alain Declercq en photographiant n’a pas fait que braver une sorte d’interdit de la représentation, il a en même temps affronté un regard de contrôle – aujourd’hui, ce n’est pas New York, ce n’est pas tant la ville qui ne dort jamais, c’est la vidéosurveillance. Je dirais ainsi que l’artiste a entrepris de faire un trou dans l’œil omnivoyant de l’Autre. Une façon de l’aveugler. Et finalement, avec le petit trou rond de sa camera obscura, en faisant soixante-dix clichés, il a réussi à faire soixante-dix trous dans le regard de l’Autre. Soixante-dix petits trous tout ronds percés dans l’œil de Méduse. Alain Declercq, oui, est Persée.
10.
L’implication du corps de l’artiste, le réquisit de sa présence n’est pas une simple idée ou une construction. D’abord bien sûr c’est un fait, mais la valeur de ce fait est à mes yeux, je l’ai dit, qu’il est nécessaire. La présence de l’artiste est fondamentale dans le « concept » même de l’œuvre. Mais il se trouve qu’un élément matériel du dispositif inclut cette présence de l’artiste, elle l’impose et vient témoigner de l’implication physique, de son corps dans l’œuvre. Ces images mettent en jeu un corps et un objet. Cela tient en effet au choix qu’Alain Declercq a fait d’utiliser comme appareil photo une camera obscura.
J’ai déjà fait allusion à cette boîte optique élémentaire pour évoquer les images rondes, en forme d’œil ou de bouclier. Mais la présence de la camera obscura ne se justifie sans doute pas dans cette affaire par la forme de l’image qu’elle produit.
Pourquoi donc aujourd’hui un jeune artiste va-t-il aller jouer les espions à New York et partir dans les rues photographier des bâtiments protégés avec un appareil
aussi encombrant et malcommode qu’approximatif ? Une identification à Tintin ? Un maniérisme ? Le goût de la difficulté ? L’amour des antiquités ? Une volonté écologique ? La défense de l’artisanat ? Un hommage à Vermeer (qui l’employait en atelier) ? Le goût de l’exploit ? Rien de tout ça, je pense.
La chambre noire, c’est simplement le contraire de la haute technologie moderne. Ceci prend immédiatement un sens précieux pour nous, à savoir que cela signifie que cet appareil a besoin de la main de l’homme. La techno-logie moderne a comme caractéristique quasi constitutive, l’automaticité. Que ça puisse marcher tout seul, se construire tout seul et fonctionner tout seul est un idéal moderne. Ça doit tourner rond et tout seul. C’est le rêve de la machine, de la machine rêvée d’où le sujet est absent – il dort ou il est en vacances. C’est l’idéal moderne du robot. A l’opposé, dans sa rusticité artisanale, la chambre noire réclame une présence et une ation humaines. Ceci est sans doute vrai déjà pour sa fabrication (il y a de forte chance qu’aucune camera obscura ne soit produite industriellement), mais aussi pour la faire fonctionner – la porter, la poser, l’orienter, y placer un film, estimer le temps de pose, ouvrir et fermer l’objectif, etc. Face à l’appareil photographique numérique qui peut être programmé, qui règle seul ses paramètres et se déclenche tout seul, la camera obscura fait figure de machine handicapée.
Il faut ajouter à cela que la camera obscura constitue un œil séparé, disjoint du corps du voyant. C’est un œil qui voit tout seul, mais aussi, du coup, en raison de sa structure rudimentaire, c’est un œil dont le voyant ne voit pas ce qu’il voit, sinon après-coup, avec tous les aléas et les surprises de cadrages que cela peut entraîner. Mais en même temps, s’il voit tout seul, comme appareil il est en effet handicapé, il ne fonctionne pas tout seul, pour prendre un cliché il a besoin d’une main.
Du coup, une première raison possible du choix de cet objet se dessine. Supposée opérer dans des zones de surveillance électronique maximale, la camera obscura d’Alain Declercq apparaît, de la même façon que l’image qui se forme à l’intérieur de la chambre, comme inversée, c’en est l’inverse absolu, c’est le contraire de la caméra de vidéosurveillance. C’est qu’au-delà de la question de ses capacités optiques et de la sophistication technologique, le contrôle électronique se définit d’abord, conformément à l’idéologie hypermoderne, de ne nécessiter aucune présence humaine pour fonctionner. C’est l’œil robot, l’automate intégral. J’ai bien évoqué dans le système de vidéosurveillance le mur d’écrans lointain, invisible, et le besoin qu’il y ait tout de même, au bout du compte, quelque part quelqu’un pour voir ce que voient toutes ces caméras, mais cette question tend elle-même à devenir sans objet, parce que des logiciels sont apparus qui ont été conçus pour équiper d’autres caméras qui auraient, elles, pour tâche de surveiller les écrans de surveillance et d’alerter en cas d’incidents, accidents, attaques diverses, etc. L’œil électronique regardé par un autre œil électronique. Le sujet peut décidément rester au lit.
Or toute la question d’Alain Declercq dans ces photographies sommaires semble pouvoir se circonscrire dans ceci : la volonté de réintroduire dans l’énorme machine anonyme et, en tous les sens, inhumaine, voire monstrueuse, qui est celle d’un état moderne surpuissant, un simple sujet. L’artiste en personne, à l’occasion. Dans cette machinerie gigantesque qui est supposée tourner à plein, le sujet ne peut apparaître que comme une tache, une perturbation, un accroc (ces quelques petites taches, les petits points alignés sur bord des images de Hidden, qui sont la trace je crois des pinces dont s’est servi le photographe, le représentent au fond très bien).
En vérité, il n’est pas question chez Alain Declercq de con-testation idéologique ou d’opposition politique, il s’agit de faire tache, soit d’introduire, d’une façon ou d’une autre, par la ruse, par la fiction ou autrement, un sujet dans un système ou un espace qui ne le prévoit pas, qui n’en veut pas, où il n’a pas sa place. Il va ainsi générer une perturbation dans le système, même si elle est minuscule – une perturbation qui puisse en tout cas se voir. Il va en somme y faire un trou. C’est là où se concentre à mes yeux l’acte artistique d’Alain Declercq. Alain Declercq est un perceur perturbateur, ou encore un artiste de la tache.
Mais du coup aussi, en allant avec sa petite boîte en bois réaliser des photographies des lieux interdits au cœur de New York, ce qu’il montre finalement, c’est, avec ces images volées des bâtiments les plus surveillés de la ville, un défaut dans le système.
Avec la jouissance de tromper un réseau de surveillance ultra sophistiqué avec juste une ridicule petite boîte en bois, la raison que je vois de l’usage de la camera obscura serait éthique. La valeur de l’acte artistique tient au fond ici aux moyens dont il se prive. Au lieu de rivaliser, de faire appel à une technologie sophistiquée contre une technologie sophistiquée, l’artiste fait le choix de la jouer presqu’à mains nues. A l’électronique d’une hyperpuissance, il oppose un pauvre objet bricolé, artisanal, primitif ; face au dispositif de défense du « complexe militaro-industriel », il dresse un petit instrument de peintre (parce qu’il est tout de même vrai que Vermeer a employé la camera obscura dans son atelier) ; à la haute technologie sécuritaire, ce qu’il oppose, c’est finalement son corps et sa ruse. Il y a en Alain Declercq du David contre Goliath. La camera obscura en fronde.
En cela, diriger la camera obscura contre la vidéosurveillance sécuritaire de New York, est le même geste que celui de lever un revolver contre un B 52. C’est une photo qu’Alain Declercq réalise en 2003, forme d’hommage à Chris Burden tirant sur un Boeing 747 dans le ciel de Los Angeles en pleine guerre du Vietnam. Sauf que ce qu’on voit, ce n’est pas une déclaration de guerre contre l’armée américaine, une réplique du geste des combattants vietnamiens tirant au fusil contre les bombardiers, pas non plus d’ailleurs la reproduction du geste de Chris Burden. D’une part, les combattants vietnamiens ont réellement abattu des avions de cette façon, et au bout du compte ils ont infligé à l’Amérique une défaite dont on mesure souvent mal combien elle l’a traumatisée. Quant à Chris Burden, même s’il ne pensait pas gagner la guerre, il a tiré réellement à balle contre l’avion. Pas Alain Declercq, qui fait juste une image. C’est d’ailleurs pourquoi il m’est possible d’en parler. Parce que je ne souhaite pas la défaite militaire de l’Amérique, et qu’en vérité, ce que montre Alain Declercq, c’est un geste d’artiste, une image, celle de l’infinie distance entre un petit revolver et l’énorme B 52. C’est une image que l’artiste tire sur la puissance, pas une balle. L’image tient la chose à distance. C’est une autre figure de David et Goliath, dans sa version artistique, celle caravagesque du pinceau contre la mort. Et c’est la petite photo floue des Hidden contre la société de surveillance.
Alors, là encore, quand Alain Declercq dégaine sa camera obscura pour tirer le portrait de ce qui incarne le pouvoir dans une ville comme New York, devant la sainte simplicité de la machine avec laquelle il entend mettre en lumière la puissance du système de défense de l’état le plus puissant du monde – en même temps que le défaut du système de défense de l’état le plus puissant du monde –, ce qui me vient encore une fois en tête, c’est le simple dispositif de miroir dont se sert Persée pour affronter la Gorgone Méduse et pour, finalement, la vaincre. Ici comme là il s’agit d’opérer une mise à distance par l’image.
C’est-à-dire qu’en faisant une image de ce qui est sous le contrôle permanent de l’Autre, dans Hidden, Alain Declercq nous donne à voir en même temps qu’il nous préserve, nous, d’être vus. Pour protéger les spectateurs de tout danger, Caravage biaisait le regard de Méduse ; Alain Declercq baise le regard de la vidéosurveillance. Ici comme là il s’agit de désamorcer le regard de l’Autre. Ainsi nous pouvons aller tranquillement au musée regarder les choses dangereuses, peintes par Caravage ou photographiées par Alain Declercq, en toute quiétude. Là comme ici, travail d’artiste. J’espère juste qu’Alain Declercq aime bien Caravage.
Gérard Wajcman est écrivain, psychanalyste et maître
de conférence au département de psychanalyse de l’Université
Paris 8. Il dirige le Centre d’étude d’histoire et de théorie du regard.
Il est l’auteur notamment de L’interdit, l’Objet du siècle, Fenêtre, et L’Œil absolu, paru chez Denoël en 2010.
Nicole Brenez /2009
Activisme et critique de l’Exécution
ALAIN DECLERCQ VIDEASTE
Le champ auquel Alain Declercq consacre son œuvre plastique et vidéographique pleine de coups de feu, d’enlèvements et de meurtres est l’Exécution, pratique nue du pouvoir exécutif. Fasciné par la façon dont la force armée sert le pouvoir, dont des appareils entiers de l’État (polices, armées, renseignements…) exécutent aveuglément des ordres pris et transmis dans une totale opacité, Declercq en détourne les symboles, les accessoires et les actions. Maquiller une Citroën de la série dite ‘Evasion’ en une voiture de police – l’institution policière n’ayant pas reculé devant l’oxymore pour équiper ses propres services, Declercq adopte l’ingenium étatique - et la prêter aux habitants d’une banlieue, à leurs risques et périls judiciaires (Exposition Make Up au Centre d’Art de Brétigny-sur-Orge, 2002) ; utiliser les préparatifs du 14-Juillet pour les transformer en une scénographie de coup d’État (film État de siège, 2001) ; récupérer l’iconographie du 11-Septembre pour muer le monde en complot général (Mike, 2005), à quoi cela sert-il ? À rappeler les logiques de pouvoir économiques, politiques et policières dont, habitants du Premier Monde, nous sommes bénéficiaires et complices, à nous montrer à quel point leurs consignes et leurs violences imprègnent notre vie quotidienne, à nous en émanciper au moins symboliquement.
Ayant élu pour motifs privilégiés les instruments et les logiques policières, Declercq relève en images la tâche qu’un philosophe de 26 ans se fixait en 1844 : « Il s’agit de faire le tableau d’une sourde oppression que toutes les sphères sociales exercent les unes sur les autres.1 » En ce sens, la police chez Declercq (sous ses différentes variantes, agent secret, gardien de la paix, soldat, CRS…) est certes une iconographie simultanément enfantine et contestataire, mais surtout, comme figure de l’obéissance, elle emblématise l’inconscience généralisée, la façon dont nous sommes des objets sociaux : tous consignés, c’est-à-dire traversés par des mots d’ordre ; assignés à un espace public restreint ; corvéables et jetables à merci. Or, comme Franz Moore, le Brigand de Schiller, révélait la cruauté du monde en déchaînant la sienne, Declercq ajoute sa désinformation ironique à la désinformation générale. Capable de fabriquer sur du papier à en-tête récupéré à Bagdad la preuve que Saddam Hussein entretient un rapport avec les attentats du 11-Septembre (ce dont les Américains sont persuadés à 42%, selon un sondage qui tournait en boucle sur CNN autour du 11-septembre 2006), Declercq affirme que Mike, film soigneusement confusionniste, est conçu « pour pouvoir prouver n’importe laquelle des thèses du complot »2. L’essentiel n’étant pas de chercher la vérité factuelle sur « la Conquête de Manhattan » - selon la terminologie islamiste -, mais bien de fabriquer sous nos yeux cet imaginaire de l’argumentation qui engendre de l’opinion. L’un des bénéfices de l’entreprise, qui consiste à détourner les événements hyper-médiatisés à la manière dont Mario Merz récupérait les tickets de cinéma et les ordures, est d’en signifier la nature réelle : aussi imposants et massifs semblent-ils, ils sont des déchets, les détritus misérables de notre consentement à ne pas prendre en considération les Hiroshima et les Nagasaki économiques qui dévastent quotidiennement le Tiers Monde.
En 1841, Marx et Bruno Bauer avaient conçu un pamphlet à teneur très particulière dont titre et principe devraient faire vibrer les cinéphiles : Trompette du Jugement dernier sur Hegel l’athée et l'antéchrist. Ultimatum, qui consistait en un grand montage parallèle : 140 citations de Hegel en regard de citations bibliques afin de faire l’éloge de ce qu’il y avait d’anti-religieux chez Hegel sous couvert de le dénoncer. (Rappelons que l’un des films fameux de l’histoire de l’avant-garde lettriste s’intitule Tambours du Jugement premier, François Dufrêne, 1951). On reconnaît ici l’une des origines historiques du détournement situationniste, dont Alain Declercq transpose les gestes dans le champ de la société de contrôle. La même dynamique court du jeune Marx, pionnier des techniques du détournement, au jeune Declercq, virtuose du simulacre dont on raconte qu'il parvient à leurrer jusqu’aux services de renseignements supposés aguerris2 : la plus modeste description du réel constitue sa critique la plus radicale. Dans cette perspective formelle qui réplique terme à terme au réel historique, l’image est utilisée par Declercq selon les fonctions crues, élémentaires, efficaces et perverses qu'elle assure, non pas dans le champ de l’art traditionnel, mais dans la sphère sociale non-esthétique : le feedback (titre plusieurs des actions de Declercq, d’un film, Feed-back / Pentagon, 2003, et qui connaît un pendant sonore avec le travail plastique sur le larsen) ; l’approximation, selon laquelle, parce qu’il y a image, il y aurait déjà information, réflexion, travail de la factualité (héritage des idéaux modernes), là où ne se manifestent en réalité qu’archétype, falsification, surveillance, domestication ; l’objectivation, qui évide le phénomène de tout poids jusqu'à en nier l’existence pour le transformer en son abject contour identitaire, ainsi que s’y emploient les caméras de surveillance.
Declercq parle spontanément dans le vocabulaire forgé par les hors-la-loi, les brigands, les mauvais garçons trop avisés et affranchis pour ce monde, Antisthène, François Villon, Arthur Rimbaud, François Dufrêne, Clyde Barrow, Andreas Baader… Mais les Provos allemands et Holger Meins qui l’ont enfanté ne lui ont pas légué la moindre forme révolutionnaire en laquelle croire. Son travail crée des griffures dans le défilement opaque du temps administré, fentes par où s’infiltre ce qui reste encore d’énergie critique, sans espoir mais sans concession.
Nicole Brenez.
1 Karl Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, in Œuvres philosophiques, tr. Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, Pléiade, 1982, p. 385.
2 Entretien avec l’auteur conduits entre le 26 juillet et le 9 septembre 2006, à Paris puis à Montréal.
3 Cf Cyrille Poy : Le Poulpe : la vérité sur les beaux bars, Isthme éditions, Le Parvis, Tarbes, 2005.
Florise pagès /2009
EMBEDDED
Paris, en plein après-midi. Alain Declercq se retrouve dans les souterrains voûtés d’une ancienne champignonnière reconvertie en stand de tir. Il s’enfonce dans les entrailles de ses couloirs labyrinthiques, accoutré d’une paire de lunettes de protection et d’un casque antibruit, un fusil à la main. L’air est transpercé de coups de feu. Ambiance de guerre, d’attaque, mais aucun signe de panique. Le calme et la froideur règnent. Personne dans les couloirs. On mitraille des chimères. Il entame ses tests de calibres, de vitesse de tir, plutôt 300km/h, d’armes, un 22 Long Rifle de préférence. Son objectif : l’impact parfait. Un bois éclaté avec précision, la poudre accrochée à la surface, les trous qui s’alignent. Les victimes : Cheney, puis Bush, Powell, Wolfowitz, Rumsfeld, Negroponte, Carlucci, Myers, Condoleezza Rice… les parlementaires américains les plus redoutables. Le titre : Rest in Peace. Portrait officiel ou inscription mortuaire ? Manipulateur d’effigies, l’artiste tire les ficelles d’un drame. Il habille les acteurs d’une scène internationale d’un maquillage de fixité, d’un sourire hollywoodien, effroyablement commercial qui ne laisse passer aucune autre expression que celle d’une réussite assurée. En même temps qu’il stigmatise ces figures politiques, il leur octroie un moyen de conservation par le biais de l’art ; un art restaurateur qui les embaume, certes, mais en les soumettant à un miroir grossissant. La dénonciation se fait par l’intermédiaire de ces marionnettes criblées, permettant à l’artiste d’opérer une mise à distance avec cette réalité politique ou sociale qu’il transpose sur le champ esthétique.
Même principe, autre méthode. Alain Declercq s’est procuré une aiguille fine, des capsules de pellicule photo complètement opaques, du gaffer noir. Enfermé dans un placard au bout du couloir de son appartement, il frappe son plan-film d’un emporte-pièce au diamètre de la capsule, installe ce disque au fond de la boîte, scotche, vérifie. Il en arme 8. Il part. Le temps est trop imprévisible pour qu’il puisse être précis dans ses calculs. Premier poste de surveillance : une sortie de métro, en face, la banque de France. Il attend que la voie soit libre. Il pose discrètement sa camera obscura sur la rampe des escaliers, soulève son doigt, chronomètre, referme, scotche, vérifie. Il faut être rapide. (Cette pratique lui avait déjà valu un interrogatoire au commissariat du Tribunal et un court séjour en garde-à-vue, lors du procès d’un supposé membre d’Al Qaeda qu’il suivait. Les policiers ont cru à une attaque bactériologique. Soulagés, ils jubilaient devant le nouvel outil qu’ils venaient de confisquer). Deuxième rendez-vous un peu plus loin, le long des quais. Cette fois-ci, il prend plus de recul. Il dégaine, à trois reprises. Alain Declercq vient de shooter le Quai des orfèvres. Il tient sa revanche : une belle image de la préfecture de police, mais prise à la sauvette, de sorte qu’elle nous fait immédiatement basculer dans une narration, voire une fiction. Cela devient systématique pour l’artiste de renverser les évènements et d’inquiéter la réalité, depuis le moment de la production jusqu’à la présentation de son œuvre au public. Il se raconte des histoires. D’où son intérêt particulier pour ces nouveaux spectacles qui envahissent notre actualité et leurs coups de théâtre invraisemblables: le crime d’état, le feuilleton politique, les manifestations, les défilés militaires, les attentats... La mise en scène prime, qu’il suive un agent secret dans sa course folle contre le terrorisme, change des SDF en soldats américains, fabrique un missile-boeing, recrée une bataille navale, réalise un camion transportant un faux chargement ou un bateau de plaisance entièrement blindé. S’il photographie les façades du siège du FBI, de la CIA, du Pentagone ou encore du Quai des orfèvres, c’est aussi parce qu’elles représentent un décor de rêve. Inlassablement, les couches de ces mises en abyme se déposent sur ses œuvres. Ses chambres noires font office de boîtes noires, elles enregistrent, en superposant les histoires sur une même bande. Arme bactériologique de fabrication artisanale, technique de télécommunication militaire, ou encore, à l’origine, appareil ennemi capturé en temps de guerre mais insondable car possiblement piégé, la boîte noire intrigue, Alain Declercq l’actionne.
Florise Pagès
Béatrice gross /2009
Proximités
"In case signals can neither be seen or perfectly understood, no captain can do very wrong
if he places his ship alongside that of an enemy."
Lord Nelson, Nelson Touch, Memorandum de la bataille de Trafalgar, 1805
Quand l’artiste ne saurait directement déjouer les formes concrètes de domination, il peut en revanche s’emparer de ses systèmes symboliques. Les investigations d’Alain Declercq mettent ainsi à nu les diverses stratégies de représentation au service de la société de contrôle.
Si le premier conflit irakien a vu les autorités américaines procéder à une stricte rétention de l’information, le deuxième volet des affrontements a donné lieu à la subordination des journalistes à la protection des troupes alliées. À cette soumission imposée des reporters “embedded”, Declercq réplique par des récits dans le récit, des “embedded stories” dirait-on en anglais. Ses mises en abyme mettent en garde contre l’illusoire transparence des idéologies dominantes: “Dans toute idéologie, les hommes et leur condition apparaissent sens dessus-dessous comme dans une camera obscura, (…) telle l’inversion rétinienne des objets de la vision”. L’artiste adopte un mouvement similaire de renversement, construisant une méta-idéologie: derrière l’apparente immédiateté de ses œuvres se trouve une machinerie complexe, écho du rapport liant propagande et machinations d’Etat. L’opacité règne souvent là où on l’attend le moins. Mimant le modus operandi de l’espion ou de l’enquêteur, créant par là plus de confusion que de dogme contestataire, Declercq “vole” des images du Palais de Justice avec une camera obscura de sa fabrication, fait passer les préparatifs du rituel défilé du 14 Juillet pour la mise en place d’un état de siège, “militarise” un bateau de plaisance brestois…
L’infinie multiplication des images semble dévorer le réel : la réalité extérieure semble ne plus exister que dans sa médiation. Or l’attentat du 11 septembre 2001 contre le Pentagone ne fut, publiquement en tout cas, représenté nulle part. Faute d’images, déclarent les autorités en place. Le doute s’instaure alors : les multiples caméras de surveillance aux alentours du ministère de la défense américain n’auraient-elles rien enregistré ? L’artiste décide de mener son enquête et photographie à la sauvette à partir de ces lieux où des images auraient dû être produites. Et crée un objet mutant, le Tomahawk American Airlines, hybride ironique inspiré de la théorie qui voudrait qu’un missile – et non un avion de ligne – ait heurté le bâtiment officiel. Ou encore, sur un mode plus cinématographique, poursuit “[sa] grande période de transparence”, ici équipé de caméra et microphone miniatures dans Mike, un docu-fiction autour des évènements du 11 septembre, et là conviant de réels détenus à jouer leur évasion, vêtus de l’habit de leurs surveillants (Escape, 2001).
L’incorporation carcérale et son modèle panoptique font d’ailleurs chez Declercq figure d’archétype de la tendance du pouvoir de contrôle à l’hégémonie: quand vouloir tout voir sert à mieux assujettir, la manie d’omniscience fait s’équivaloir vision, savoir et pouvoir. En juin 2005, les agents de la Direction de la Sécurité du Territoire pensaient ainsi tout savoir des activités d’Alain Declercq, “de raison sociale ‘plasticien’, selon ses propres termes, signifiant “artiste”, en réalité chaînon manquant entre Al Qaida et l’ETA. Alors que nombre d’acquittements se font précisément au nom du respect et de la protection du statut juridique de l’œuvre d’art, c’est bien celui de l’artiste qui fut ici incriminé: ne serait-ce pas là la couverture parfaite? Durant son interrogatoire, sous la menace, Declercq finit par avouer le motif de sa démarche: “mon point de vue était de surveiller ceux qui surveillaient”. Surveillance et tendances paranoïaques d’Etat appellent selon lui les contre-offensives artistiques de mise en abyme et mimesis critiques. Avec humour et dérision, l’artiste, inspiré par les réformes de la sphère politique soviétique vers plus de transparence, invente ainsi Glasnost 1 et 2 (2005), attaché-cases à double-fond laissant affleurer fusil d’assaut et arme de poing.
Il est vrai que le doute est parfois permis. Lorsque les forces de l’ordre semblent être devenues leur propre satire, Declercq n’hésite pas à jouer avec les limites de la légalité. Ainsi, sur un même mode de faux-camouflage sarcastique, il crée une réplique parfaite d’un véhicule de police qu’il propose à la location: si l’automobile garée dans le centre d’art est bien protégée par son statut d’œuvre, une fois sur la voie publique, elle rend son conducteur (et propriétaire) passibles de poursuites judiciaires. En la matière, Declercq pourrait reprendre à son compte les propos de Dennis Oppenheim au sujet de ses Violations (1971-72) “I was creating objects that could turn against me, contaminate, spread my activity through the gallery-museum system, imbuing all with possible legal repercussions.”
Sa sculpture en mouvement, tel un mobile d’un nouveau genre, Crash Cars (2001), lui valut ainsi de nouvelles difficultés avec les autorités. Un dispositif minimal met en scène deux voitures, et aucun conducteur – ou presque. Declerq met comme en orbite, jusqu’à épuisement, les deux véhicules, tournant chacun en rond, se croisant aux deux points d’intersection de leur trajectoire circulaire respective. L’artiste développe ici une géométrie empirique du risque: c’est que rien dans le réel n’est parfaitement géométrique et les voitures risquent constamment d’entrer en collision. En écho à la nature originelle de la géométrie, science de la mesure du terrain, il s’agit ici d’induire une appréhension nouvelle de l’espace à travers un dispositif intrinsèquement menacé de désordre. Ce giro littéral mime-t-il l’absurdité inquiétante, quasi comique, des équilibres fragiles de la Guerre Froide ? Ou rappelle-t-il les rotations méthodiques des B52s en partance pour l’Irak que Declercq, dans son hommage à Chris Burden, photographia in extremis avant de se faire à nouveau arrêter? Poursuivant cette logique circulaire, l’artiste explore divers phénomènes de feed-back. Il met ainsi littéralement en boucle le système de surveillance d’un centre d’étude marketing. Dans une acception plus métaphorique de la rétroaction, il porte sa réflexion sur les rumeurs et théories du complot.
Si les tactiques de Declercq divergent, sa stratégie demeure identique: celle non pas d’une itération redondante, mais plutôt d’une “proximité artistique” à travers des décalages infra-minces. Au fond, son œuvre interroge l’essence même du document, plus “brut[e] et énigmatique” que la vulgate veut bien le croire. En créant par exemple une série de fausses preuves venant appuyer diverses thèses de complot, qui de versets incriminants sur le papier à en-tête de Saddam Hussein, de polaroïds trafiqués ou de manuel terroriste, il interroge non seulement les phénomènes de falsification et de désinformation, mais plus profondément l’efficacité de l’image photographique. Dans ce contexte, sa production d’images revient à une prise de pouvoir, celle de la formation d’un contre-pouvoir symbolique. Renversant l’impératif de discrétion de la surveillance, Declercq, dans sa série Welcome Home Boss (2001), choisit d’exhiber la captation d’un regard intrus : l’artiste prend en filature les “hommes puissants” de Montréal afin de localiser le domicile de chacun. À l’aide d’une tour surmontée de puissants projecteurs alimentés par un groupe électrogène remorqué par un pick-up, il photographie, de nuit, la maison du maire, celles de riches industriels. Est toujours inclus au premier plan l’imposant dispositif d’éclairage. Si l’aveuglante lumière artificielle pointée vers ces lieux domestiques du pouvoir contraste violemment avec les ombres nocturnes, ce n’est pas tant sur le ton d’une éventuelle dénonciation politique ou sociale mais bien plutôt sur celui d’un commentaire sur la posture de l’artiste, adepte du chiaroscuro, dans une tension dramatique aiguë entre transparence spectaculaire et obscurité romantique.
Marx L’Idéologie Allemande, “Thèses sur Feuerbach, A, IV.
Hidden Camera Obscura, Quai des Orfèvres, Paris, 2007
Détournement situationniste à voir dans son œuvre vidéo éponyme, Etat de siège, 2001.
Jolly Roger, 2002
Feed-Back/Pentagon, 2005
Conversation avec l’artiste, 7 février 2008
Déposition de l’artiste, 2001
L’artiste choisit précisément le modèle Evasion de Citroën utilisé par la police nationale.
Cité dans legal/illegal [Wenn Kunst Gesetze bricht/Art beyond Law] n.p.
Voir le compte-rendu de Michel Nurisdany à l’occasion de la Biennale du Caire, 2001
B 52 (2003) rejoue 747 (1973) de Chris Burden.
Il produit des larsens, plaçant les enceintes contre les microphones, des images fractales, braquant les caméras sur les écrans.
Voir Feed-Back/Pentagon (2003) par exemple.
C’est par ces mots que l’artiste justifia, lors de son interrogatoire, son infiltration dans un groupe de policiers et CRS dont il filma équipement et comportement.
Mike (2005): “Je n'avais jamais remarqué qu'il filmait, je crois d'ailleurs n'avoir jamais rien compris de ses réelles activités. J'ai donc décidé de n'être qu'un intermédiaire, et de vous livrer ces documents comme je les ai eus en main, bruts et énigmatiques”.
Copie de documents mis en ligne sur le site de la CIA.
JEANNE SUSPLUGAS /2009
Attention Declercq !
(Manifeste)
À travers ses installations, ses photographies, ses dessins et ses films, Alain Declercq explore les différentes structures du pouvoir et les oppressions qu'elles engendrent – schizophrénie sécuritaire, surveillance, manipulations médiatiques. Sa technique de l'inversion transforme Declercq en chasseur d'indices, provocateur de dysfonctionnements, renverseur de situations ou empêcheur de tourner en rond.
Pour aboutir à ses fins, il n'hésite pas à s'investir, sans gilet pare-balles, en s'exposant en permanence par la filature, l'infiltration, l'enquête ou la manipulation. Declercq a réussi à transposer le genre du roman d'espionnage dans le champ des arts plastiques – puisque c'est bien de l'art de l'espionnage dont il est question ici.
L'œil critique que Declercq pose sur notre monde contrarie notre quotidien et agace nos certitudes. Entre réel danger et contre-pied absurde, l'apparente paranoïa de l'artiste fait sourire, inquiète ou fait grincer des dents.
Jeanne Susplugas
LA REVANCHE DU MONDE /2006
NICOLE BRENEZ
Le 24 juin 2005, à Bordeaux, la brigade criminelle et la brigade anti-terroriste débarquent dans l’atelier d’Alain Declercq. Celui-ci prépare Mike, un film sur l’iconographie du complot international, dans la lignée de ses œuvres sur le 11-Septembre et sur la société de contrôle. Declercq est interrogé, l’atelier fouillé, documents et ordinateur disséqués. Nous pouvons ainsi mesurer la puissance d’analyse de nos services dits de renseignements, incapables de distinguer entre le réel et sa réflexion. Depuis, Alain Declercq a terminé son film, devenu mythique grâce à la dst.
Declercq n’en était pas à son premier attentat réussi contre les logiques du contrôle. « Where you goin’with that gun in your hand », « One man shot », « Knife show, « état de siège » : voici quelques-uns des titres de ses expositions personnelles. Le champ auquel se consacre son œuvre plastique et vidéographique pleine de coups de feu, d’enlèvements et de meurtres est l’Exécution, comme pratique pure de l’Exécutif : fasciné par la façon dont la force armée sert le pouvoir, dont des appareils entiers de l’État (polices, armées, renseignements) exécutent aveuglément des ordres pris et transmis dans une totale opacité, Alain Declercq en détourne les symboles, les accessoires et les actions. Maquiller une Citroën de la série dite « Évasion » en une voiture de police – l’institution policière n’ayant pas reculé devant l’oxymore pour équiper ses propres services, Declercq adopte l’ingenium étatique – et la prêter aux habitants d’une banlieue, à leurs risques et périls judiciaires (Exposition « Make Up » au Centre d’Art de Brétigny-sur-Orge, 2002) ; utiliser les préparatifs du 14-Juillet pour les transformer en une scénographie de coup d’État (film État de siège, 2001) ; récupérer l’iconographie du 11-Septembre pour muer le monde en complot général (Mike, 2005), à quoi cela sert-il ? À rappeler les logiques de pouvoir économiques, politiques et policières dont, habitants du Premier Monde, nous sommes bénéficiaires et complices, à nous montrer à quel point leurs consignes et leurs violences imprègnent notre vie quotidienne, à nous en émanciper au moins symboliquement. « Quand un bateau était pris par les pirates, s’ils le débaptisaient, la plupart du temps apparaissait le mot « revanche » ou « revenge », « revenge of ». Donc, je me suis dit, je construis mon « revenge ». J’ai la liberté de proposer un objet comme celui-là ; le champ des arts plastiques autorise ce genre de propositions et il faut pouvoir accepter la lenteur de la pratique et l’irréversibilité du geste. /1 » Grâce au pirate Alain Declercq, l’art devient la revanche du monde. Le mode d’emploi constitue son apogée formelle. De même que dans Octobre, Eisenstein s’attachait à décrire concrètement le montage d’une mitraillette ou Holger Meins dans ses films d’agit-prop la composition du cocktail Molotov, Escape (2001), chef d’œuvre vidéographique d’Alain Declercq, nous ex-plique pratiquement comment se déroule une évasion, avec ce paradoxe, explique l’artiste, que le prisonnier ayant récupéré un costume de garde, « visuellement, tout au long du film, c’est un gardien qui s’évade /2 ».
« Officiant pour l’affaire 88776/C/ FG. Affaire sur le territoire de Bourges – 18000 –Déposition de M. Declercq devant les Commissaires Poret et Boisdet
Greffe : L. Quillerié
Lors de son interpellation, M. Declercq, né le 6 novembre 1969 à Moulins (Département de l’Allier, France), de raison sociale « plasticien » selon ses propres termes signifiant « artiste » de nationalité française résidant à Paris, 4, rue des Filles du Calvaire, 3e arrondissement, a été con-duit au Commissariat Central. Au cours de sa déposition, M. Declercq a avoué qu’il n’en était pas à son « premier coup » (délit). Lors du plan VigiPirate en 1998, M. De-clercq s’est introduit frauduleusement au sein des forces de police. Selon ses dires, cette introduction n’était qu’une « proximité artistique ». Cependant, il déclare aussitôt que son point de vue était de surveiller ceux qui surveillaient. »Alain Declercq, Autoportrait. /3
Ayant élu pour motifs privilégiés les instruments et les logiques policières, Alain Declercq relève en images la tâche qu’un philosophe de 26 ans se fixait en 1844 : « Il s’agit de faire le tableau d’une sourde oppression que toutes les sphères sociales exercent les unes sur les autres. » /4 En ce sens, la police chez Declercq (sous ses différentes variantes, agent secret, gardien de la paix, soldat, C.R.S.) est certes une iconographie simultanément enfantine et contestataire, mais surtout, comme figure de l’obéissance, elle emblématise l’inconscience généralisée, la façon dont nous sommes des objets sociaux : tous consignés, c’est-à-dire traversés par des mots d’ordre ; assignés à un espace public restreint ; corvéables et jetables à merci. « La critique qui s’attaque à cette matière est un corps à corps et, dans ce corps à corps, qu’importe que l’adversaire soit du même rang, noble ou intéressant ; l’important, c’est de le toucher. » Voilà le principe fondamental, horizon esthétique et butée concrète tant pour le philosophe que pour l’artiste activiste : que la pensée possède une efficacité pratique. Or, la critique ne s’exerce pas d’abord au nom d’un autre état du monde où la justice serait réalisée, elle ne se réduit en aucun cas à un antagonisme entre le négatif (l’état effectif du monde) et le positif (un état virtuel souhaitable). Elle instaure, fondamentalement, une vrille du négatif. « Il faut rendre l’oppression réelle encore plus oppressive, en lui ajoutant la conscience de l’oppression, rendre la honte plus honteuse encore, en la divulguant ». Ainsi, comme Franz Moore, le Brigand de Schiller, révélait la cruauté du monde en déchaînant la sienne, Declercq ajoute-t-il sa désinformation ironique à la désinformation générale. Capable de fabriquer sur du papier à en-tête récupéré à Bagdad la preuve que Saddam Hussein entretient un rapport avec les attentats du 11 septembre (ce dont les Américains sont persuadés à 42 %, selon un sondage qui tournait en boucle sur cnn autour du 11 septembre 2006), Declercq affirme que Mike, film soigneusement confusionniste, est conçu « pour pouvoir prouver n’importe laquelle des thèses du complot ». L’essentiel n’étant pas de chercher la vérité factuelle sur « la Conquête de Manhattan » – selon la terminologie islamiste –, mais bien de fabriquer sous nos yeux cet imaginaire de l’argumentation qui engendre de l’opinion. L’un des bénéfices de l’entreprise, qui consiste à détourner les événements hyper-médiatisés à la manière dont Mario Merz récupérait les tickets de cinéma et les ordures, est d’en signifier la nature réelle : aussi imposants et massifs semblent-ils, ils sont des déchets, les détritus misérables de notre consentement à ne pas prendre en considération les Hiroshima et les Nagasaki économiques qui dévastent quotidiennement le Tiers-Monde.
On voit que les enjeux du travail de Declercq sont considérables, et graves. Comme pour désamorcer ce que de telles perspectives pourraient avoir de démesuré pour un simple artiste privé de tout pouvoir autre que symbolique, une plastique du jouet s’interpose immédiatement : les petits soldats, les flics, les gardiens, les voitures, les revolvers, les camions de pompiers, les tanks, les villages noyés, les circuits automobiles, tout apparaît sous les auspices du simulacre, de la panoplie, des joujoux préférés de l’enfance à laquelle on a offert la Loi sous forme de fétiches amusants. Peut-être ne s’agit-il pas tant, au fond, de mettre à nu les ressorts de la société de contrôle, que de retrouver à chaque fois l’absorption enchantée dans laquelle nos jeux d’enfant nous ont plongé, pour les seuls moments de bonheur profond que la vie nous offrira jamais.
En 1841, Karl Marx et Bruno Bauer avaient conçu un pamphlet à teneur très particulière dont titre et principe devraient faire vibrer les cinéphiles : Trompette du Juge-ment dernier sur Hegel l’athée et antichrist. Ultimatum, qui consistait en un grand montage parallèle : 140 citations de Hegel en regard de citations bibliques afin de faire l’éloge de ce qu’il y avait d’anti-religieux chez Hegel sous couvert de le dénoncer. (Rappelons que l’un des films fameux de l’histoire de l’avant-garde lettriste s’intitule Tam-bours du Jugement premier, François Dufrêne, 1951). On reconnaît ici l’une des origines historiques du détournement situationniste, dont Alain Declercq transpose les gestes dans le champ de la société de contrôle. La même dynamique court du jeune Marx, pionnier des techniques du détournement, et le jeune Declercq, virtuose du simulacre qui parvient à leurrer jusqu’aux services de renseignements supposés les plus aguerris /5 : la plus modeste description du réel constitue sa critique la plus radicale. Dans cette perspective formelle qui réplique terme à terme au réel historique, l’image est utilisée par Declercq selon les fonctions crues, élémentaires, efficaces et perverses qu’elle assure, non pas dans le champ de l’art traditionnel, mais dans la sphère sociale non-esthétique : le feedback (titre plusieurs des actions de Declercq, d’un film, Feed-back / Pentagon, 2003, et qui connaît un pendant sonore avec le travail plastique sur le larsen) ; l’approximation, selon laquelle, parce qu’il y a image, il y aurait déjà information, réflexion, travail de la factualité (héritage des idéaux modernes), là où ne se manifestent en réalité qu’archétypie, alsification, surveillance, domestication ; l’objectivation, qui évide le phénomène de tout poids jusqu’à en nier l’existence pour le transformer en son abject contour identitaire, ainsi que s’y emploient les caméras de surveillance.
Alain Declercq a inventé une version imagée de l’oppo-sition entre l’art officiel et les pratiques de l’avant-garde. Artistes « embedded » contre « wildcats », les « embarqués » contre les « chats sauvages » : Declercq a transposé un terme apparu dans l’espace public en 2003, lorsqu’il fut annoncé que les images de la seconde guerre en Irak ne pourraient être prises que par des journalistes « embedded », c’est-à-dire subordonnés à la logistique et donc au point de vue de l’armée américaine. Alain Declercq donne un exemple précis d’un geste clair, simple, qui pourtant se heurte à la passivité résignée et complice de l’appareil médiatique et devient donc irrecevable. « En mars 2003, quelques semaines après le début des bombardements américains sur Bagdad, j’ai réalisé la photo B 52, un hommage à Chris Burden tirant sur un Boeing 747 en pleine guerre du Vietnam. De retour d’Angleterre (de la base us de Fairford) où les bombardiers faisaient des rotations méthodiques, j’ai agité tous les contacts que je pouvais avoir dans la presse quotidienne pour leur proposer (gratuitement) cette image. Personne n’en a voulu, malgré la position de la France dans cette affaire. Pourtant, deux mois après la victoire annoncée et la fin explicite des actes de guerre, tous les journaux l’ont publiée. La guerre est finie, parlons-en ! » /6. Declercq, lui, parle spontanément dans le vocabulaire forgé par les hors-la-loi, les brigands (au sens de Schiller), les mauvais garçons trop avisés et affranchis pour ce monde, Antisthène, François Villon, Arthur Rim-baud, François Dufrêne, Clyde Barrow, Andreas Baader... Mais les Provos allemands et Holger Meins qui l’ont en-fanté ne lui ont pas légué la moindre forme révolutionnaire en laquelle croire. Alors, aujourd’hui, que faire et surtout, pourquoi faire ce que l’on fait ? « Je crois que la tâche de démystification est infinie, inépuisable. Là, vraiment, on peut donner sa vraie dimension au concept de révolution permanente. » /7 Le travail de Declercq crée des griffures dans le défilement opaque du temps administré, fentes par où s’infiltre ce qui reste encore d’énergie critique, sans espoir mais sans concession.
michel nuridsany /2003
D'une biennale l'autre.
C'était au Caire, il y a un an. Nous étions partis là-bas, ensemble, avec
Alain Declercq. Jany Bourdais m'avait nommé pour effectuer la sélection
française des deux biennales égyptiennes et pour évaluer la nécessité de
notre présence dans ces manifestations peut-être un peu trop exclusivement
tournées vers la Méditerrannée. Pour Alexandrie j'avais choisi deux très
jeunes artistes: Jeanne Susplugas, Liu An-chi et quelqu'un de plus âgé, pas
vraiment reconnu à sa juste valeur: Jean-Claude Ruggirello, pour Le Caire,
Alain Declercq et Joël Bartoloméo. Association pas très originale (elle
venait d'être faite ailleurs, aux Beaux Arts de Rouen) mais qui, me
paraissant bonne, me plaisait ainsi. Le second, pris par je ne sais trop
quoi, n'était pas venu, ce qui ne l'avait pas empêché de bouder à la fin de
la manifestation parce que je ne lui avais pas fait renvoyer sa bande vidéo
complètement hors d'usage après un mois et demi de passages incessants et
parce que je ne lui avais pas rapporté un catalogue...
S'il l'avait vu, le catalogue, avec ses "trous" innombrables marquant
l'absence de photos (notamment celles qui avaient été envoyées par e-mail
et qui n'avaient pu, ainsi, être utilisées), il se serait moins alarmé.
C'est que la biennale du Caire n'est ni celle de Venise ni celle de Sao
Paulo. C'est une biennale pauvre, dirigée par des artistes académiques,
soucieux de leur statut et de leurs prérogatives, une manifestation
courageuse, hors du temps, qui se maintient dans le contexte de la guerre
du Proche-Orient toute proche, dans une atmosphère de contrôle militaires
et policiers, visibles ou invisibles, incessants.
Alain Declercq, qui était allé au Caire repérer les lieux, qui était revenu
pour y réaliser son intervention, lui, avait parfaitement compris dans quel
contexte nous opérions. Celà n'empêche pas notre aventure, là-bas, d'avoir
été passablement mouvementée.
Alain Declercq, qui travaille toujours en fonction du lieu dans lequel il
intervient, n'aime pas beaucoup, dit-il, reprendre une pièce qu'il a déjà
réalisée ailleurs. Il a raison. Toutefois, au vu de l'invraissemble et
fascinante circulation cairote, il avait décidé de réactiver son
intervention réalisée à Brétigny. Il s'agissait, tout simplement, de faire
tourner, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sans chauffeur,
en bloquant le volant et l'accélérateur, une voiture puis une autre qu'il
faisait entrer dans le cercle de la première, les voitures se croisant,
menaçant de se toucher à chaque tour, ménageant ainsi une impression de
risque et de danger.
Lorsqu'Alain Declercq m'avait fait cette proposition, étant donnée la
circulation automobile au Caire, j'avais été emballé. Je n'imaginais pas ce
qui allait suivre.
Alain Declercq non plus.
Les bâtiments où se déroule la biennale ont été implantés autour d'une
vaste esplanade piquée ça et là de gazon et de jardins municipaux. C'est
là, sur la partie bitumée, qu'Alain Declercq avait décidé de faire tourner
les voitures. Il avait demandé des Mercédès à cause de la présence
policière et militaire: ce sont les voitures ordinaires des officiels
locaux. Paul Fournel, attaché culturel et écrivain, nous avait obtenu une
location à bas prix en nous recommandant la prudence: il avait du donner
des garanties plus ou moins personnelles. "Pas de problème: Alain Declercq
est un artiste sérieux. il a déjà réalisé avec succès l'oeuvre à Brétigny.
Le coup est sûr ". C'est ce que je m'entend dire et c'est ce que je pense à
cet instant.
L'esplanade et les bâtiments sont gardés par des militaires bornés comme le
sont les militaires qui ont des ordres et qui les exécutent. Pas question
d'entrer avec nos deux Mercédès, du moins sans autorisation écrite. La
présence d'un représentant de l'ambassade de France n'y change rien. Il
faut garer les voitures, parlementer, aller trouver le directeur de la
biennale, artiste lui-même, homme délicieux, lui expliquer la situation,
l'inviter à se déplacer, le laisser discuter avec les militaires qui
consentent enfin à nous laisser passer. C'est compter sans le deuxième
cercle, policier celui-là, qui nécessite des palabres au moins aussi
longues. J'avais prévenu l'ambassade longtemps à l'avance. J'avais insisté
sur les problèmes de sécurité à résoudre, les autorisations à obtenir.
L'ambassade avait fait son travail, obtenu les assurances; mais,
apparemment, tout se décide et s'obtient, ici comme ailleurs souvent, au
dernier moment.
Une heure plus tard, nous voici sur l'esplanade. Il nous reste deux jours.
A Alain Declercq d'exercer ses talents. Le voici déjà, pendant qu'un autre
policier s'avance pour me demander ce que nous faisons là, qui arpente le
bitume de ses grandes jambes d'insecte et qui prend la mesure de son
territoire. Il grimpe dans la voiture, tourne. Avec quoi va-t-il coincer le
volant ? Il a apporté des ficelles. Impraticable: elles glissent. Sur place
nous obtenons des sandows: impraticable également. Reste la ceinture. Voici
la première voiture, parfaitement instrumentalisée. On la regarde tourner.
Comme une victoire.
Sous le regard torve des policiers pas très heureux de nous voir là.
Mais, alors que nous nous apprêtons à mettre sur orbite la seconde, nous
voyons, comme dans un mauvais rêve, une petite camionnette approcher,
approcher lentement, inexorablement, entrer dans l'orbite de la Mercédès,
et, tout aussi lentement, tout aussi inexorablement, la prendre à la
sortie, violemment, en plein flanc. Le conducteur de la camionnette,
chargée de quelques militaires ou bien de policiers, s'arrête un instant,
descend de son véhicule regarde les dégâts occasionnés, apparemment s'en
accomode, et s'en va. Je cours, je hurle: Eh! eh ! Pas comme ça ! Arrêtez !
Il faut faire un constat ! Mais la camionnette ne s'arrête pas. Je suis
obligé de m'acrocher. Finalement le conducteur s'arrête, et, de méchante
humeur, me demande ce que je veux. Un constat. L'assurance va nous
demander un constat. Comprend-il ?
Il éteint son moteur, prend ses clefs. Bien. Les militaires (ou les
policiers) descendent du véhicule. Apparemment ce sera long !
Direction le poste de police. Premier bureau: ce n'est pas celui-là.
Deuxième bureau: un personnage me demande ma nationalité, me dit de
m'asseoir. Alain Declercq, qui s'occupait de ranger la Mercèdés accidentée,
est venu me rejoindre. Une interprète arrive. Que se passe-t-il ? Je lui
explique les faits; mais, tout en parlant, je me rend compte de
l'invraissemblable de la situation: une voiture sans chauffeur -la notre-
tournant en rond a percuté une camionette qui passait par là et nous nous
plaignons ! Mais je maintiens la pression: je veux un constat. Ah ce n'est
pas ici qu'il faut vous adresser, me dit-on: il y a un bureau spécial pour
les touristes, juste de l'autre côté de l'esplanade. Je vous conduis. Et
nous voilà partis, avec le chauffeur de la camionnette et l'interprète.
Dans le bureau d'en face un chef quelconque (Inspecteur ? Sergent ?
Commandant ?) boit son thé. On le dérange. Qu'est-ce que c'est encore... Je
lui répète mon récit, m'entendant répéter: "constat", "assurance"... Lui,
sourit finement. Un homme en civil qui se trouve là, et qui parle français,
(est-ce un policier en civil ?), en désignant le chauffeur de la
camionnette du menton, me lance à mi voix: C'est un policier. Même si vous
avez raison, vous avez tort.
Le chef finit son thé, repose lentement son verre d'un geste arrondi et me
dit qu'on est en Egypte, n'est-ce pas, et que, bien sûr il peut enregistrer
ma plainte mais que, sans doute, elle n'aboutira pas. Il ajoute, comme
l'autre, que le conducteur de la camionette est policier et que celà lui
donne l'avantage sur nous, que cette histoire de voiture qui roule toute
seule est amusante, certes, artistique peut-être, mais que l'assurance ne
l'entendrait sans doute pas d'une oreille aussi complaisante que l'est la
sienne...
Et l'homme déroule un chapelet d'attendus, de réflexions, de formules
fleuries.
Il ne me reste plus qu'à lui demander: Alors, que devons-nous faire, que
pouvons-nous faire vis à vis du loueur ?
Que faire ? Il nous le dira; mais je ne peux pas le répéter ici parce que
ce n'est pas très légal... J'avoue pourtant avoir sauté sur l'occasion,
finalement soulagé. Et, apparemment lui-même l'est, soulagé.
On se serre la main. On se donne même l'accolade. On plaisante. On se tape
dans le dos. Tous, dans le fond, ravis de l'arrangement.
D'un commun accord avec Alain Declercq, nous décidons de rentrer prendre
une douche à l'hôtel. L'envie de continuer aujourd'hui lui a passé. A moi
aussi.
Le lendemain matin, à 9 heures, sur l'esplanade, quand nous arrivons, les
grands policiers barraqués et moustachus nous accueillent avec de larges
sourires. On se tape dans la main. On lève le pouce. Ca va ? Ca va.
L'information a circulé dans tout l'espace dévolu à la biennale (et à la
police). C'est tout juste s'ils ne déroulent pas le tapis rouge pour nous,
s'ils ne règlent pas la circulation pour nous...
Ah, que ne l'ont-ils fait ! Voici qu'Alain Declercq fait tourner sa
première voiture, coince le volant, l'accélérateur, saute en marche tout en
souplesse et regarde un moment la belle Mercédès glisser sur son orbite.
Fasciné. Prêt à lancer la seconde. Attentif à prendre la mesure du
cercle... C'est alors qu'une camionnette apparaît, approche doucement,
coupe la trajectoire de la voiture, comme la veille. Mais, contrairement à
l'autre, celle-ci ralentit. Nous lui faisons de grands signes pour qu'elle
avance, pour qu'elle accélére; mais la voilà qui s'arrête, juste à
l'endroit où... la trajectoire de notre Mercédès la rattrape. Nous hurlons,
nous lui faisons des signes affolés: Avancez ! Rien n'y fait et, à 20 à
l'heure, presque tranquillemnt, la Mercédès enfonce la camionnette dans un
grand chuintement de tôles froissées.
Le conducteur sort de son véhicule, fou de rage, mais il est vite cerné par
"nos" policiers qui tempèrent ses ardeurs, qui lui enjoignent de se calmer
et lui conseillent de ne pas nous chercher d'ennuis: nous sommes sous leur
protection. A la fois en plein rêve et en plein cauchemar.
Et le pauvre homme s'en va piteusement, filant doux et pestant.
Les flics nous aident tant bien que mal à remettre en place le pare-choc
enfoncé, l'aile froissée, appellent un mécanicien qui rafistole tout celà
en masquant les choses plutôt qu'en les réparant.
L'après-midi, Alain Declercq remet en piste la première Mercédès puis,
enfin, la seconde. Que se passe-t-il: presqu'immédiatement les deux
voitures entrent en collision. Trop c'est trop. J'éclate de rire. Alain
Declercq est catastrophé. A la vérité moi aussi.
Que vont dire les assurances ? Dans quel embarras allons-nous mettre Paul
Fournel ?
En tout cas une décision s'impose. Nous ne pouvons pas continuer ainsi.
Alain Declercq décide alors de supprimer une voiture et de se contenter
d'en faire tourner une seule. Apparemment, ici, celà suffit à étonner.
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises: nous découvrons le lendemain
matin, à 9 heures, jour de vernissage qu'à l'emplacement où nous avions
pris nos marques une grande sculpture est en cours d'installation avec une
grue et une vingtaine de manoeuvres. Je file chez le directeur de la
biennale. Que se passe-t-il ? Son beau front se plisse de quelques rides.
Il se lève et vient voir. Obtient du sculpteur qu'il tempère ses velléités
expansionnistes. Mais celà ne suffit pas. Je sens Alain sur le point de
craquer.
Non: il s'agit maintenant de gagner du terrain centimètre par centimètre.
Ce que je fais en repoussant imperceptiblement, des madriers destinés à
baliser l'espace de la scultpure, qui trainent par terre. Le vernissage est
à onze heures. Déjà les groupes folkloriques se mettent en place, essaient
flûtes et tambours, quand, après moult essais en tous sens, le sculpteur,
blanc de rage, décide de tout remballer: il n'expose plus. Quelle bonne
idée: à nous la place ! Vite Alain Declercq s'installe au volant de l'une
de nos voitures les moins amochée, bloque tout, saute en souplesse. Il y a
foule. Dans un quart d'heure c'est le discours d'ouverture. En attendant,
la Mercédès constitue l'attraction.
Mais, à la manière des camionnettes d'hier et d'avant hier, des passants
traversent la trajectoire de la Mercédès, insouciants, habitués à la
circulation cairote, n'imaginant pas un instant que la voiture ne va pas
s'arrêter pour les laisser passer, échappent de peu au heurt avec le
véhicule traçant imperturbablement sa route circulaire, héberlués lorsqu'on
hurle ou que je fonce sur eux pour les soustraire à l'accident. Trois fois,
cinq fois, dix fois.
Autour de nous les spectateurs se marrent. Pas nous. Ah, vite, que tout
celà s'arrête ! Alain Declercq me passe sa caméra. Mission: filmer
l'intervention dans cette ambiance de kermesse. Nous allons arrêter la
Mercédès dès la fin du vernissage et nous ne garderons que la vidéo. Faire
tourner la voiture est trop dangereux. Alain Declercq prend à son tour la
caméra.
Nous évoquions tout celà avec de grands sourires, le 18 mars, la veille de
mon départ pour la biennale de Sao Paulo. De là je revenais à Paris où je
restais une journée pour donner mon article, puis repartais à Séoul et
Gwangju pour une autre biennale.
J'enregistrais. Alain Declercq parlait. De son appartement qui s'écroulait.
De la police. "Jamais je n'aurais cru que j'aurais pu avoir ce genre de
rapport avec des policiers " disait-il, évoquant nos rapports étranges,
presqu'euphoriques, avec ceux du Caire.
De la police il m'avait abondamment parlé, tout au long de l'entretien et
en particulier, cette fois, des mégaphones utilisés pour appeler les gens
par leur nom dans certains quartiers: "Madame machin, descendez, c'est la
police " et ça réveille tout le quartier. "Ici, où tu habites c'est
impensable mais ailleurs ça ne l'est pas ".
Hasard ? A Sao Paulo, deux jours plus tard je tombais sur une manifestation
syndicale fermement ceinturée par un nombre phénoménal de policiers. Un
tous les mètres. A peu près un pour cinq manifestants ! La démocratie dans
toute sa splendeur répressive...
A Séoul, huit jours plus tard, manifestation encore, embouteillages
monstres, matraques géantes, échauffourées gigantesques. Et à Gwangju, au
sud-ouest du pays, la biennale qui utilisait pour la première fois le parc
de la Liberté du 18 mai où, au début des années 90, le régime militaire
avait tiré sur la foule des étudiants, faisant des centaines, voire des
milliers de morts, sans compter les tortures.
J'écoutais la bande réalisée à Paris quelques jours auparavant, la voix
rapide, boulée, d'Alain Declercq évoquer son intervention à Brétigny, si
semblable à celle du Caire, hors du Centre d'art, fermé à l'époque pour
cause de rénovation, sur le parking, au milieu de la cité, avec des
"Laguna" "des voitures de la classe moyenne " disait-il, ajoutant "j'avais
envie d'animer ce lieu mais c'est la tension, plus encore, qui
m'intéressait. Entre les voitures qui se frôlaient et menaçaient toujours
de se heurter... mais aussi avec les gens: jouer à un vrai jeu de gamin
avec des voitures d'assez haut standing pour le quartier, celà faisait
grincer des dents ".
Quand il fait livrer une Rolls Royce de deux tonnes, toute noire avec des
sièges en cuir rouge, vulgaire en diable, à Nantes pour l'ouverture de la
Zoo galerie, l'arrivée d'un objet au standing aussi clair, la présence d'un
symbole aussi fort, dans un quartier populaire aussi dur, crée des débats
tendus, des réactions. L'artiste installe sous la voiture une bulle
gonflable dont l'extrêmité se termine par un tuyau qu'il introduit dans le
pot d'échappement du véhicule. Le gaz gonfle la bulle qui agit comme un
cric et la voiture s'incline, se met en biais de manière absurde, bancale.
Façon de se situer de guingois, d'agir en décalage, d'enrayer plutôt que de
révolutionner, de glisser plutôt que de heurter, de proposer une autre
manière de voir, de se comporter, de vivre peut-être.
Il réalise une vidéo. Le fait-il toujours ? Non, mais, de plus en plus, à
partir de cette époque. Il s'efforce de lier la vidéo aux installations.
Ainsi à "Transpalettes", dans la banlieue de Bourges, il transforme la
friche culturelle en prison et tourne là une de ces vidéos en boucle qui
caractérisent sa pratique. On voit un gardien de prison -du moins quelqu'un
habillé en gardien de prison- qui tient en respect un groupe de gens, qui
court, avale un escalier, explose une verrière et attrape la corde que lui
lance un hélicoptère. L'engin fonce, survole la campagne. c'est là que la
boucle se met en place.
Sur les lieux, dans la guérite de contrôle où le maton est supposé regarder
les caméras de surveillance, tous les rushes du film étaient diffusés.
Alain Declercq entretient un curieux rapport avec les rushes. Un jour la
question mériterait d'être analysée.
La question du lieu -du travail en fonction du lieu- chez Alain Declercq
est primordiale. C'est en voyant la friche qui, selon lui, ressemblait à
une prison qu'il eut l'idée de la vidéo puis de la transformation du lieu.
Le danger était de transformer la friche en décor. D'où l'idée de la
guérite de contrôle où aboutissent tous les rushes, toutes les images.
Le lieu sert donc de déclencheur.
"Je n'ai pas un travail d'atelier. Ca m'arrive très rarement d'avoir une
pièce autonome. Comme avec la vidéo intitulée "Etat de siège" qui fait
ressembler Paris à Prague au moment du "Printemps de Prague". On voit les
rues de Paris désertes avec des chars partout. En fait ce sont les rues de
Paris désertes avec des chars d'assaut partout. En fait Declercq a filmé
les Champs Elysées et ses abords tôt le matin pendant trois ans avant le
défilé du 14 juillet. L'oeuvre avait été diffusée une première fois sur
Icono puis au Fresnoy.
Ce qu'on observe dans le travail d'Alain Delcercq c'est la place qu'y tient
moins la violence ostentatoire que l'autorité, les techniques de contrôle
et de surveillance. Dès son post diplôme, il utilisera des figures de
l'autorité comme le gradin, en s'en moquant, en renforçant son caractère
absurde, en embrouillant les planches de bois avec une allégresse de sale
gamin.
1998: c'est l'époque du plan "Vigipirate". Les flics et les militaire
"envahissent" Paris. 98, avec ses manifs, avec ce 9 qui paraît un 6 à
l'envers, c'est, à l'envers, 68. "Feedback", le film qu'il réalise là
dessus fonctionne comme une pirouette. Le propos d'Alain Declercq est
simple : "Je vais surveiller les surveillants pour voir comment on est
surveillé ": il repère un groupe de CRS d'assez loin en essayant de prendre
de la hauteur. Il zoome, se rapproche, se rapproche au point de filmer les
CRS, à la fin, à moins de vingt centimètres. "Mon rapport à l'autorité, à
l'ordre public a toujours été un peu difficile, dit-il. Je me faisais
vraiment violence en m'approchant ainsi. Ce film m'a libéré de pas mal de
choses ".
Il fonctionne en boucle, lui aussi.
Alain Declercq rapproche ce travail de celui qu'il intitule "Vis à vis",
inscrit sur un CD-Rom. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 2 minutes, pour
"Feedback", on a compris; mais ça dure 30 minutes. Pour le CD-Rom intitulé
"Vis à vis", réalisé en 1999 avec 42 fenêtres, c'est presque la même chose.
Dès qu'on a cliqué sur une fenêtre et que la vidéo s'est mise en route, on
a compris. Les vidéos sont des séquences courtes réalisées à partir de chez
Alain Declercq montrant tout ce qu'on peut voir de sa fenêtre,
C'est anecdotique, assez obsessionnel. Pendant trois mois toutes les nuits
il se met à sa fenêtre et il filme. "Je n'avais pas d'atelier, je possédais
une caméra, dit-il. C'était en même temps sexuellement très orienté. Ca
joue beaucoup là dessus: l'excitation de la fenêtre. Ca n'allait pas
beaucoup plus loin; mais ça m'a donné une grande liberté de tournage ".
Et un premier succès et une première alerte. "Dès ma sortie de l'école on
m'invitait à faire des expositions mais on ne m'invitait pas moi, on ne me
demandait que ce CD-Rom. je donnais mon CD-Rom et je m'en allais. J'avais
d'autres choses dans le crâne mais j'avais du mal à le dire ".
C'est sans doute à ce moment-là qu'Alain Declercq décide de ne plus
travailler que par rapport au lieu. Comme il en a assez qu'on ne l'invite
que pour montrer ce CD-Rom, il décide d'aller voir ceux qui s'adressent à
lui, d'aller regarder à quoi ressemble le lieu de l'exposition et de dire:
"Votre lieu m'intéresse, voilà ma proposition ". C'est ainsi que, parfois,
s'opèrent des changements profonds dans la vie d'un artiste.
Celà se situe très exactement au sortir de l'école, à la fin de ses études.
Ses études, elles méritent qu'on s'y arrête un instant. "Si j'avais été
informé -je ne l'étais pas- il aurait été logique que j'entre aux beaux
Arts après le Bac. Pour de multiples raisons je me suis dit que les Arts
Appliqués, ce n'était peut-être pas mal ".
Il entre à Olivier de Serre et il fait de la "communication visuelle".
C'est une première étape. Mais il ne supporte pas la pub. Mauvaise
orientation. Il s'en échappe en faisant de la photo.
Comme à chaque étape de sa formation, une rencontre lui permettra de s'en
sortir. Ici ce sera un photographe qui l'initiera au travail du labo, au
portrait, au reportage. Il est pris aux Arts Déco avec un dossier orienté
vers le reportage; mais, au moment où il entre, il commence à s'intéresser
beaucoup plus aux Arts Plastiques. "C'était une situation ingérable,
dit-il. A leurs yeux la photo était tellement limitée, que, déjà, tu
faisait une photo couleur tu avais un problème. Tu avais envie de coller
une photo sur un support ou de la déchirer, n'importe quelle manipulation
d'image ça ne passait pas. Le premier rendu que j'ai fait aux Arts Déco,
j'étais là depuis deux semaines, je montre un truc, le prof arrive et me
dit: "La merde, j'en ai assez vu pour aujourd'hui, je ne regarde même pas,
dégage ". J'ai détesté les Arts Déco. C'était une école pas créative pour
deux sous. Sauf que j'y ai rencontré un mec génial ". Encore. Patrick
Jeanne. De lui il dira que c'est la personne qui lui a le plus "ouvert la
tête". Il lui permettra de découvrir ce qu'il a envie de faire, vraiment.
Il passe quand même ses diplômes aux Arts déco. Heureusement: celà lui
permet d'entrer en post diplôme à Nantes. En même temps il est prof à
Paris.
"J'ai eu une formation arts appliqués, dit-il. Aujourd'hui je ne m'en
plains pas: si j'ai une idée, j'arrive à trouver le moyen de la réaliser en
vidéo, en photo, en sérigraphie ".
Il est encore en post-diplôme quand il réalise une pièce hautement
significative avec effet de Larsen, dans un lieu étrange, qui ressemble à
une galerie mais qui sert à des "test-clients", loué par des entreprises.
Par exemple, s'il s'agit d'une entreprise de nourriture pour chat on réunit
quinze personnes -qu'on rétribue- et on leur demande : "A quelle heure
mange votre chat ?", "Qu'aime-t-il ?", "Lui faites vous des calins ?" etc..
Et, en fonction des réponses, on propose de nouveaux produits. Dans ce lieu
il y a des micros incrustés dans les murs, des caméras de surveillance, un
énorme miroir sans tain.
Alain Declercq va mettre en boucle tout le système de surveillance. Il y
avait dans la salle de réunion deux micros super design grands comme des
bouches d'aération reliés à une petite salle derrière le miroir sans tain
où des gens avec casque, bloc-note observaient les autres, leur
comportement. Alain Declercq tire les ralonges des enceintes et il ramène
chaque enceinte en face des micros, ce qui crée un Larsen, rendant inutile
tout ce système de surveillance obsène. Il installe aussi douze hallogènes
de 500 watts dans la petite salle, ce qui va inverser la polarité du
miroir. De la salle de réunion on voit donc les gens derrière leur miroir.
Et c'est l'observateur qui est observé.
Chez Valentin Alain Delercq se servira de la musicalité apparue avec le
Larsen. Quand on marche, qu'on claque dans ses mains, quand on parle, tout
celà vient rebondir dans le Larsen.
La vidéo montrée en même temps, chez Valentin, est la première tentative de
narration d'Alain Declercq où l'on se retrouvera plusieurs faits concrets:
l'assassinat de Mesrine, l'élection de Chirac à la mairie de Paris quand
les motocyclistes de la télévision, en cortège, l'avaient suivi en "live"
absolu, toute la construction du film se faisant autour de cette image-là.
Il y a une grande ligne droite, une voiture qui roule. Alain Declercq est
sur une moto, derrière le conducteur, avec sa caméra et un flash en
batterie: le parfait équipement télé, suivant une voiture prise sous les
feux des sunlights.
C'est avec un équipement encore plus imposant et fait pour être vu, pour en
imposer, qu'Alain Delercq va se promener sur un "pick up à l'américaine"
avec une génératrice électrique de chantier, dans le quartier chic de
Montréal, se poster devant une villa qu'il éclaire de toute la puissance de
ses floods comme la villa d'un criminel. Et photographie. La villa. Le
dispositf. Il s'agit, là encore, d'un retournement.
Souvent Alain Declercq procède ainsi, qui n'est pas loin de la boucle. Mais
qu'en est-il de ce qu'il nomme ses "faux en écriture" qui constituent l'une
des dérives les plus troublantes de son activité ? Un "retour à l'envoyeur"?
De quoi s'agit-il ? Quelqu'un envoie à Alain Delercq une lettre et ce
dernier répond à son correspondant avec son écriture en signant "Alain
Delercq". Comment ? Il scanne toutes les lettres de son correspondant une
par une, un "r" en milieu de mot n'étant pas le même qu'en fin de mot, et
il fait une typo Macintosh: il tape alors sur son clavier et, ce qui sort,
est une lettre avec l'écriture du correspondant. Alain Declercq possède une
collection impressionnante de signatures qui lui permettent, en fait, -ou
lui permettrait- tous les faux en écriture; mais l'ensemble lui donne aussi
la possibilité de semer agréablement, à sa guise, la zizanie autour de lui.
Imaginez...
Etrangement Alain Delercq considère cette activité comme du dessin. Mais
comment nomme-t-il, alors, cette activité proche qui consiste, lorsqu'il
doit rencontrer un écrivain, un essayiste, à apprendre par coeur quatre ou
cinq phrases compliquées d'un de ses ouvrages à les ressortir dans la
converation au grand trouble de l'interlocuteur ?
" C'est une façon, pour moi, d'entrer dans l'intimité des gens, dit-il. Pas
frontale. Je n'aime pas affronter les gens de face. C'est une infiltration".
Pendant un moment, par rapport à la surveillance Alain Declercq a fait pas
mal de pièce au premier degré. La vidéo surveillance des flics de ses
débuts est même du super premier degré. Aujourd'hui, de plus en plus, il
évolue dans ces renversements qui l'amusaient jusqu'alors, jusqu'à faire
participer la police à son travail au Palais de Tokyo.
Ce seront des gens de la police qui ont eu un rapport (indirect) avec
Mesrine. "Pour moi c'était intéressant de travailler avec ces gens là.
L'idée de la pièce, au départ, était de faire une palissade dans laquelle
des impacts de balle dessinaient un mot: "Instinct de mort". Et puis l'idée
peu à peu a germé de faire écrire ces mots par des gens proche de cet
évènement là. Je me suis retrouvé face à un flic à l'opposé de la
caricature qu'on peut s'en faire. Je lui avais dit "vous savez c'est au
Palais de Tokyo, dans le XVI°, juste en face du muée d'art moderne. Je ne
sais pas si vous savez où est le musée d'art moderne". Il m'avait répondu:
mais je suis un flic qui va au musée. Bon. N'empêche, c'était, c'est un
tireur d'élite... Je me suis dit: je fais entrer la police directement dans
mon travail: qu'est-ce que ça veut dire ? " Le jeu se complexifie. En
Egypte nous avions retournés les flics en notre faveur en les attirant sur
notre terrain, en les amusant. Au Palais de Tokyo, Alain Declercq avait
fait écrire la phrase de Mesrine ("Instinct de mort") par un flic qui,
probablement, l'avait traqué et il l'avait, finalement, disait-il, employé
comme un ouvrier, à tirer 650 balles pendant deux fois 1/2 heure.
Mais à Brétigny ? Lorsqu'il maquille une voiture (une Citroën "Evasion"...)
en voiture de police et propose à qui veut tenter l'expérience de
l'emprunter pour faire un tour dans la cité proche, celui qui est tenté,
que peut-il faire ? On lui met sous le nez deux articles du code pénal
(433-15 et 433-22) qui l'alertent sur les dangers d'un tel geste, de même
qu'un "contrat de prêt" plus que dissuasif. Il ne s'agit donc pas de se
donner des frissons pendant quelques minutes, de risquer de se faire
arrêter par les vrais flics ou caillasser par les voyous. Non: au lieu
d'observer l'observateur ou de perturber le système, ici on vous suggère de
vous mettre dans la peau d'un flic, d'imaginer de l'intérieur ce qu'est
l'autorité, la surveilance et de comprendre ses mécanismes et ses ressorts.
Au Caire c'était autre chose. Peut-être un pas de côté dans l'exception
culturelle égyptienne.