SB TE 2010
SAMUEL BIANCHINI
PRISE DE VUE
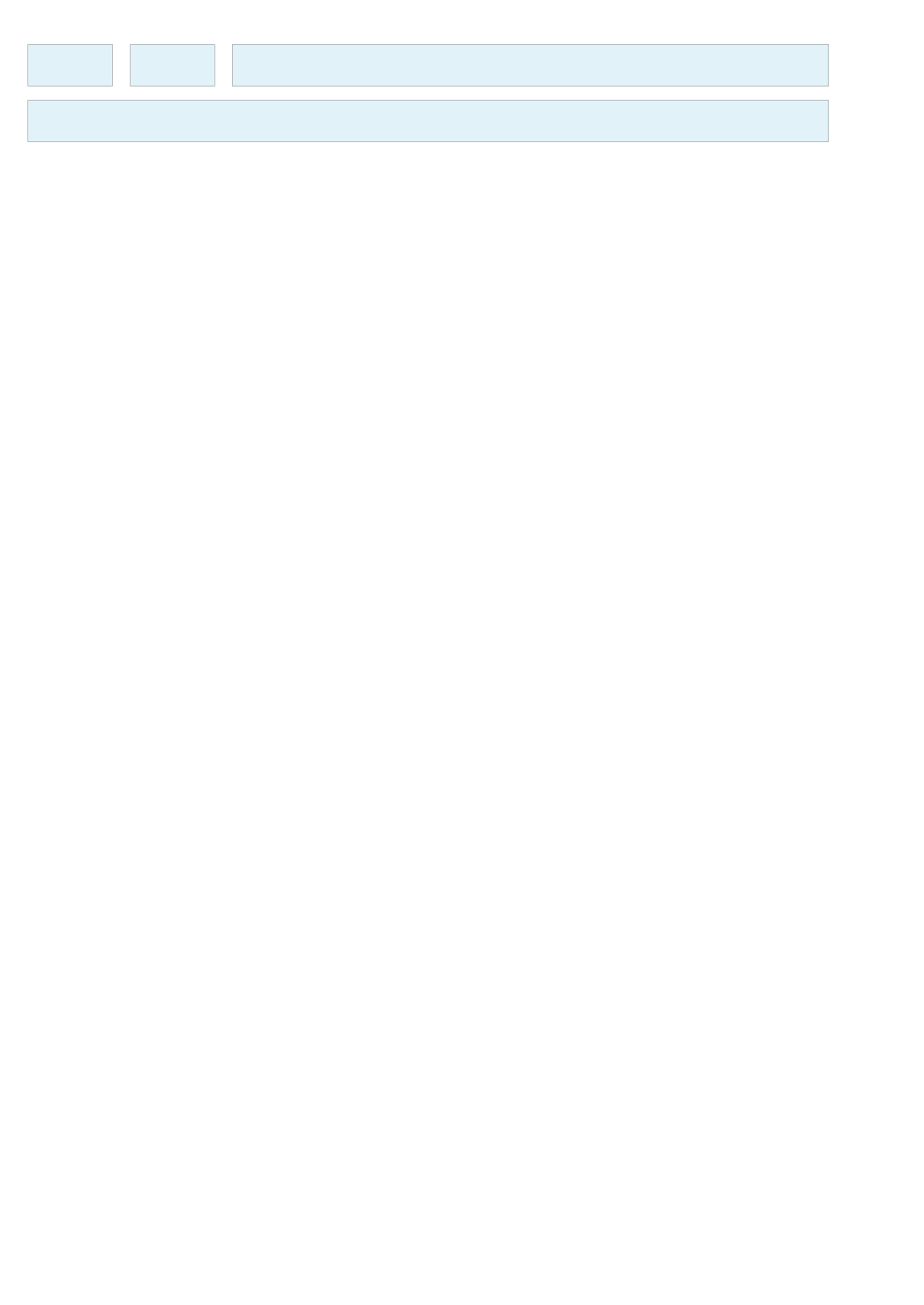
SB TE 2010
SAMUEL BIANCHINI
PRISE DE VUE





Tirer, se cacher ou cacher, dissimuler, fausser, enquêter, simuler, maquiller, feindre ; autant d’activités au registre d’Alain Declercq. Pourtant, ce qui est sûrement central dans son travail reste la prise de vue. Celle-ci ne doit pas être comprise dans son seul sens habituel, mais bien plus comme une prise de judo, mieux, d’aïkido : comment utiliser un rapport de forces en renversant celui-ci, en utilisant la force de l’autre pour en jouer, la retourner ou simplement l’exposer, là où elle ne souhaite pas s’afficher ? Dès lors, la prise de vue ne se focalise plus sur l’instant du déclenchement, mais plutôt sur les conditions de ce qui va permettre cette action et même cette opération.
Pour qui suit depuis longtemps le travail d’Alain Declercq, celui-ci s’est effectivement construit avec et contre la photographie. D’abord, au début des années quatre-vingt-dix, comme il se doit, l'artiste, proche d'un documentariste, semble rechercher l’honnête rapport à l’autre, pour ne pas le réduire à un sujet, impliquant une attitude au service de l’image et de son sujet. Une décennie plus tard, à l’encontre de ces bonnes manières, Alain Declercq réalise des photographies représentant des protagonistes pris de dos - tels des policiers pour la série Security - ou pris sans même les regarder, selon un cadrage dédaigneux autant que hasardeux, effectué du bout du bras, pour les SDF de la série Shut. Ces séries photographiques prouvent, s'il le fallait, un changement radical, pour ne pas dire un renversement, dans le rapport d'Alain Declercq à la prise de vue. Et, aujourd'hui, s’il continue de produire des images, ce n’est pas sa seule préoccupation. Plus que le support et la forme du résultat, ce qui semble retenir toute son attention, ce sont les conditions de la prise de vue, de l’événement qui fait image et des mises en scène nécessaires pour cela.
Loin du support photographique, pensons, par exemple, à cette installation de deux œuvres réalisée en 2003 à la Galerie VKS, à Toulouse. Une maquette d’un grand hangar industriel est surplombée d’un vieux panneau métallique « Total Fina Elf », dont la partie finale manquante, arrachée, produit une nouvelle lecture de cette marque : Total Fin. C’est le titre donné à ce panneau et, simplement, Fin, à la maquette sur laquelle, le soir du vernissage, vint s’écrouler un large plafonnier à néons. Ce dernier ravagea en grande partie cette maquette pour constituer un événement puis un paysage de désolation aux tristes résonances dans cette ville, Toulouse, traumatisée par l’explosion d’une usine de ce même groupe. Résultante d’une opération, d’un déclenchement, cette “installation-performance” procède finalement d’un “arrêt sur objet”. Considérée au prisme d’une démarche photographique, c’est comme si cette mise en scène se fixait elle-même plutôt que d’attendre, au “final”, d’être fixée par l’image.
Adoptant une logique proche, mais cette fois pour la photographie, You’re under arrest joue du redoublement entre support et sujet : comment fixer par l’image un sujet qui, lui-même, est contraint à l’arrêt ? Est ainsi organisée la mise en rapport - la “prise” de l’une sur l’autre, pourrait-on dire - d’une opération de représentation et d’une opération physique.
Welcome Home Boss est exemplaire de cette démarche conjuguant toujours plus mode de représentation et mode opératoire, au sens où on pourrait le dire d’un commando. Parcourant de nuit les banlieues aisées de Montréal avec un véhicule remorquant de puissants projecteurs de lumière blanche, Alain Declercq stationne devant de grosses maisons bourgeoises, les éclaire fortement et en fait une photographie, à la fois subrepticement et posément : avec un appareil 6x6 et un matériel qui relève plus d’un équipement de studio que de celui d’un reporter. L’extérieur est traité comme un intérieur, l’espace public s'immisce dans la vie privée, le retrait confortable est exposé et même surexposé. Le cadrage est tel qu’il donne à voir le contraste entre la nuit noire environnante et le halo de lumière ainsi que le dispositif de projection même.
Le champ lumineux redouble le champ photographique. La prise de vue est autant une captation qu’une projection : elle affirme son action et sa matérialité, son opération. Et celle-ci est aussi symbolique ; elle se pose en face à face, en défi à l’égard d’une population peu enclin à une mise à l’index aussi directe, condescendante voire violente : entre interrogatoire, descente de police ou, plus largement, révélation. L'image nous incite à remonter le cours de l'opération qui l'a permise et à qualifier cette opération : quelle action ? quelle attitude ? quel danger ? quelles autorisations ? comment a-t-il fait ? que représente cette opération ?
Ainsi, à l’instar de Welcome Home Boss tout autant que de Fin ou You’re under arrest, pour Alain Declercq, la prise de vue relève d’une triple approche couplant une dimension symbolique aux modes de représentation et modes opératoires qui sont les siens. Et, plutôt que de nous focaliser sur le résultat, il tend à nous en faire remonter le cours :
1- qu'est-ce qui est représenté à l'image ?
2- quel moyen est utilisé pour réaliser cette représentation ?
3- que représente l'opération effectuée par l'artiste pour réaliser cette représentation ?
La prise de vue est à comprendre selon ces trois registres et sûrement dans cet ordre : elle est une performance pour l’image, action autant opératoire que symbolique oblitérée par sa capacité à faire image.
Fixant la confrontation d’Alain Declercq avec une réalité sociétale trop imposée à son goût, la représentation ne peut être pour lui que le fruit d’un conflit, d’une prise. La prise de vue est ainsi une lutte entre l’autorité de l’artiste et celle du pouvoir : policier, politique, militaire, judiciaire, industriel, voire morale. Plus que l’image, c’est l’opération qui va la permettre et, même, qui va l’autoriser qui importe.
Comment l’artiste, avec les moyens qui sont les siens, peut-il contourner, déjouer, retourner, la loi, le pouvoir et les représentations que ce dernier impose ou défend, qu’il protège et / ou interdit ? Quelles tactiques employer alors ? Et comment faire la preuve de ces activités, de ces opérations de contre-représentation ? C’est-à-dire aussi comment l’image peut-elle représenter, en creux, l’action, la performance qui l’a permise autant et même plus que son “sujet” ? En apportant des réponses à ces questions, par ses faits et gestes, Alain Declercq donne l’exemple, révèle ou même défie les conditions et les limites de la représentation érigées par une autorité en surplomb.
La série de photographies en caméra obscura amorcée au procès de Jamel Béghal, puis poursuivie avec la série Hidden Camera doit ainsi être comprise comme la manifestation d’une performance photographique : ces images prennent appui sur leur sujet pour renvoyer au principe opératoire déployé par l’artiste afin d’assurer une prise de vue défendue. L’image est une interface, elle incarne, d’une part, des interdits, le plus souvent juridico-politiques, et, d’autre part, l’activité de son créateur qui met à l’épreuve ces derniers ; il fait ce que l’on ne doit pas faire. Et ce langage juridico-politique qui ordonne est fondamentalement performatif : son seul énoncé revient à accomplir une action. Il a le pouvoir de faire, faire faire, défaire et interdire de faire.
Alliant d’emblée le symbolique et l’opératoire, il offre un champ, et même un contre-champ parfait pour les performances d'Alain Declercq : des opérations de contre-représentation ou de dérèglement de la représentation à l'instar de son œuvre Make up. Installation et potentiellement performance, celle-ci consista à exposer une voiture (modèle Citroën Évasion), maquillée aux couleurs de la police, que le public pouvait emprunter et donc remettre en circulation, à ses risques et périls.
Alain Declercq se rapproche de la dynamique de ce qu’il est convenu d’appeler les “médias tactiques”, appellation héritée de la pensée de Michel de Certeaux pour désigner les médias que l’on fait soi-même afin de contrer une pensée dominante véhiculée par les masses médias trop peu indépendants du pouvoir politique et économique. En ce sens, ce travail peut être perçu à la lumière du conflit rampant entre anciens et nouveaux médias qui permettent non seulement de jouer en contre, mais aussi d’organiser de nouvelles formes d’activisme.
Ici, apparaît une zone de turbulence au cœur du travail d’Alain Declercq, une zone de conflit moins apparente et peut-être aussi moins consciente que celles mises en scène et en image par l’artiste, mais tout aussi révélatrice des problématiques que rencontrent nos modes de représentations contemporains : comment opérer avec et selon les modalités d’un média constatif par essence, la photographie ? Car, le dérèglement médiatique que l’on vit actuellement et qui s’installe progressivement ne procède-t-il pas principalement de ce fait : les modes de représentation des XIXème et surtout XXème siècles, fondés sur la photographie, étaient avant tout constatifs. Ils visaient à rendre compte de la réalité plus qu’à directement la transformer. Ce qui, brièvement, semble changer aujourd’hui, est une tendance à créer et à maintenir un lien, une indexation, entre réalité tangible et représentation, et, dans la mesure du possible, à passer de la captation à la prise. Car, si un lien est maintenu, alors représentation et réalité tangible peuvent donner lieu à des opérations de l’une sur l’autre, à des prises, qu’elles soient de l’ordre de la coopération ou de la confrontation.
Entre deux siècles, entre deux régimes médiatiques, Alain Declercq met à l’épreuve ces modes de représentation en les impliquant dans un champ performatif contre nature. Figée, décontenancée, la représentation appelle à remonter le cours de ce qui l’a constituée : les luttes de pouvoir dans lesquelles elle est prise, elle a été prise. Si Alain Declercq appelle à des prises de conscience, il en marque autant la nécessité que l’insuffisance, car, la question qu’il nous retourne est également pratique : comment donner prise(s) ? Comment contrer ou se départir de l’emprise d’une société du spectacle qui tend à se renouveler et à s’accorder avec une société de contrôle en plein essor ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
(1)À l’instar du terme anglais “shooter”, utilisé aussi bien pour l’action de photographier que celle de tirer avec une arme, c’est assez naturellement que l’artiste passe de la photo au tir, en particulier avec sa série Rip, dans laquelle la multiplication des impacts de balle sur du bois plastifié recrée l’image d’un sujet conflictuel : portrait d’hommes politiques va-t-en guerre, frontière disputée, etc.
(2) Hidden est aussi le titre d’une performance effectuée de l’autre côté de la caméra cette fois. L’artiste s’y met en scène grimé pour ne pas être reconnu, dans son propre vernissage. À l’instar de cette ancienne installation, Vis à vis, écran présentant de multiples petites fenêtres vidéo à activer pour voir ce qui se passait dans la possible intimité de voisins épiés par l’artiste.
(3)La notion de “performatif” provient de la linguistique, de « l'opposition établie par le philosophe anglais John Langshaw Austin, au début de sa réflexion sur le langage, entre énoncés performatifs et constatifs. Un énoncé est appelé […] performatif s'il se présente comme destiné à transformer la réalité (c'est le cas par exemple pour un ordre) ». Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed. du Seuil, Coll. “Points Essais”, 1999, article Langage et action, p. 781.
Samuel Bianchini est artiste, maître de conférence à l’université
de Valenciennes, et enseignant à l’EnsadLab, laboratoire
de recherche de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris. Il interroge notamment l’incidence des dispositifs
technologiques sur nos modes de représentation, nos nouvelles
formes d’expériences esthétiques et nos organisations socio-politiques.
Il est responsable scientifique du projet de recherche Praticables
(ANR-08-CREA-063, 2009-2011) soutenu par l’Agence Nationale
de la Recherche.