NF TE 2006
NINA FOLKERSMA
DOSSIER ALAIN DECLERCQ
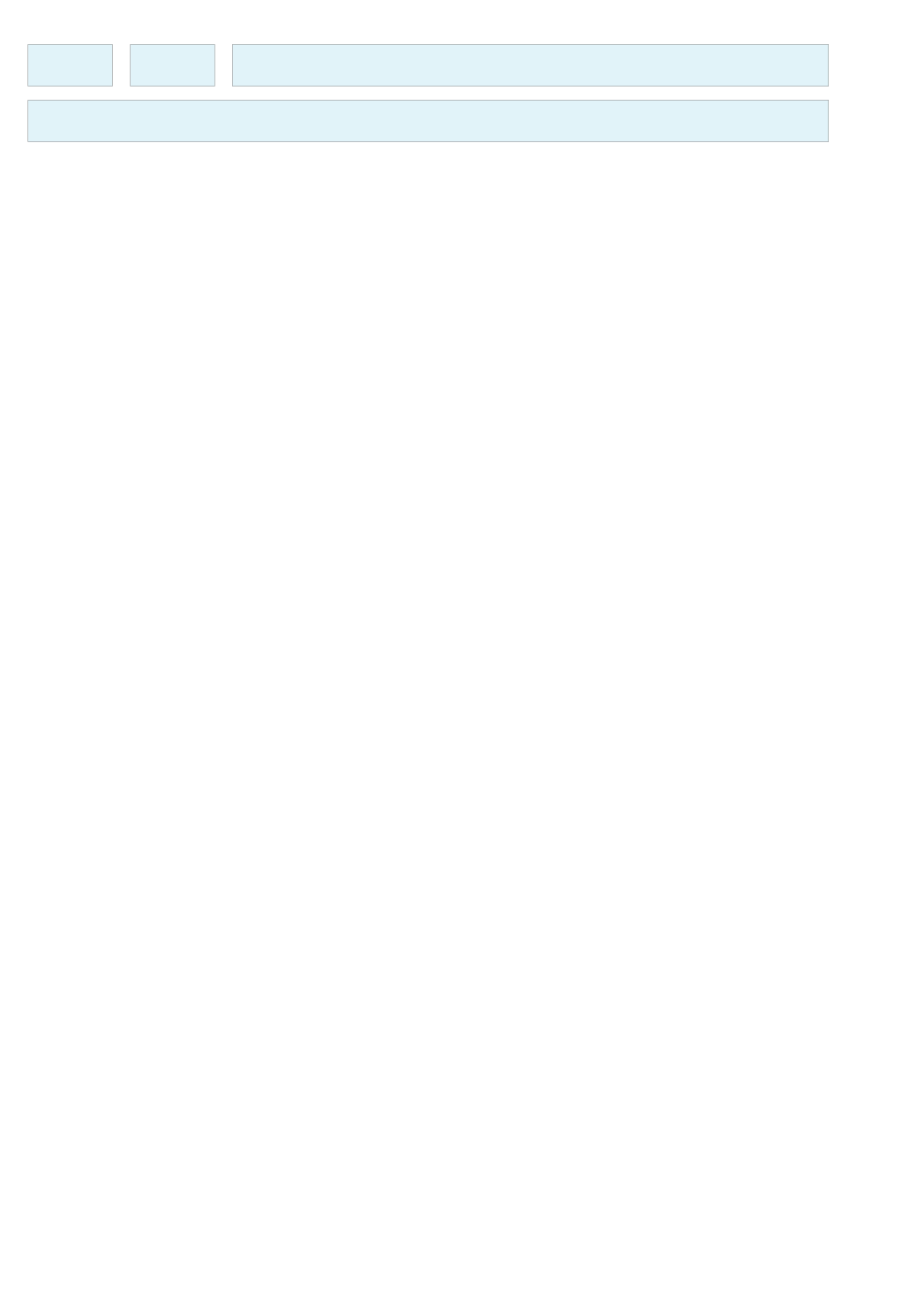
NF TE 2006
NINA FOLKERSMA
DOSSIER ALAIN DECLERCQ





Jeudi 20 février 2003, 22h40
13 avenue du Président Wilson, Palais de Tokyo, Paris
Un homme à l’arrière d’un taxi, un ordinateur portable sur les genoux, roule dans Paris la nuit. À ses côtés, un autre est occupé à tout filmer. Sur l’écran du portable apparaissent les images d’un Pentagone dévasté, et une voix off insiste sur l’inconsistance des déclarations officielles américaines après les événements du 11 septembre 2001. Le taxi pénètre lentement dans le sous-sol d’un immeuble. L’homme à la caméra sort du véhicule et se dirige vers un entrepôt, au milieu duquel se dresse un projectile gigantesque, entre les trois et quatre mètres de long, de forme cylindrique et d’un blanc immaculé. Un impeccable missile – étrangement pourvu d’une minuscule paire d’ailes d’avion. La caméra s’approche et révèle l’inscription sur le flanc du projectile : le logo bleu-blanc-rouge de la compagnie aérienne American Airlines.
À l’inauguration de l’exposition Hardcore au Palais de Tokyo, une semaine plus tard, un couple de gens âgés découvre la vidéo d’Alain Declercq. De temps à autre ils jettent un regard inquiet vers la sculpture, dans leur dos : croisement hybride de projectile militaire et d’avion civil, une « arme de destruction massive » extraordinairement redoutable et séduisante. Je m’approche de Declercq et lui demande comment cette œuvre est née. Il m’explique que les théories et les explications autour du 11 septembre stimulent depuis longtemps sa curiosité et ses recherches. Bien entendu, il a lu à peu près tout ce qui s'écrit sur le sujet, et déclare : « Je ne défens aucune théorie en particulier. Mais, compte tenu de l’absence de toute enquête indépendante, je crois important de convaincre les gens de la légitimité de se poser des questions à propos de ces événements. »
Mi-avril 2003, heure non précisée
Base militaire US, Fairford, G.B
L’artiste est debout au milieu d’une prairie à Fairford (sud de l’Angleterre). De là, la vue est imprenable sur la base aérienne américaine, toute proche. Un B-52 rempli de bombes s’apprête à décoller à destination de l’Irak. Declercq dégaine son pistolet et le pointe en direction du colosse volant. L’image que Declercq a tirée de ce geste est, outre une photographie éminemment « chargée » (dans tous les sens du terme), aussi un hommage détourné à une œuvre réalisée par Chris Burden en 1973, à l’époque de la guerre du Vietnam. Sur cette photo, Burden est dans une position identique et dirige un revolver en direction d’un Boeing 747 américain, dans les airs.
Cette photo est un bon exemple de l’univers de Declercq, dont le travail oscille entre violence et résistance. Déstabiliser, perturber, dérégler sont ses principales stratégies. En ce sens, il va même plus loin que Chris Burden : en pointant l’arme vers un avion militaire plutôt que civil, il place la confrontation au tranchant de la frontière entre violence réelle et violence symbolique… On ne s’étonnera pas de le voir étiqueté « agent provocateur ».
Lundi 22 mars 2004, 10h
Paris (adresse inconnue)
Declercq est en conversation avec un ancien agent des services de renseignement français. Il se sont déjà vus, mais Declercq veut réentendre son histoire – la matière de son film. L’agent secret, spécialiste des images satellite, était chargé, lors de la première guerre du Golfe, d’étudier les images des bombardements en Irak. Declercq lui soumet quelques clichés de l’attaque du 11 septembre sur le Pentagone et lui demande son avis. Selon l’agent de renseignement, en aucun cas il ne peut s’agir de l’impact causé par un avion : la percée dans le bâtiment est tout simplement trop petite et trop profonde pour avoir été provoquée par la chute d’un avion de ligne. Seul un missile aurait pu ainsi se frayer un chemin à travers les remparts du Pentagone. De plus, les images montrent qu’il s’agit incontestablement d’une « explosion d'explosif » dont on ne saurait tenir le seul kérosène pour responsable. L’expert souligne enfin l’absence de la moindre trace de fumée noire.
Ce verdict conforte la théorie de Thierry Meyssan qui, dans “L’Effroyable Imposture”, avance que le 11 septembre serait en réalité un coup monté par les Américains, et les attentats une mise en scène destinée à justifier la grande offensive de George W. Bush, à l’assaut d’un pouvoir mondial. Le livre, publié en 2002 et traduit en 28 langues (mais pas en néerlandais !), a atteint en France des records de vente. Un journaliste du Volkskrant en a profité pour observer que la France était une société pétrie de méfiance, et donc davantage encline à verser dans les théories du complot : le soupçon est toujours le terreau où fleurissent les idée de conspiration. Les adeptes de la théorie du complot perchaient surtout à l’extrême-droite, mais on commençait à en trouver de plus en plus également au sein de la gauche radicale. Thierry Meyssan n’est donc pas isolé. Comme le dit le journaliste du Volkskrant : « Le complot relève du patrimoine français au même titre que le croissant ou le béret basque. » En ce sens, Alain Declercq serait donc un artiste typiquement français, la défiance vis-à-vis du pouvoir et de l’autorité étant la clé de sa pratique artistique.
Samedi 26 mars 2005, 15h30
Fête foraine sur le Dam, Amsterdam
Alain Declercq est en visite à Amsterdam, à l’occasion d’un événement consacré aux théories du complot. Il projette un court métrage et explique que le film auquel il travaille, Mike, traitera des pérégrinations d’un agent secret en quête de réponses aux questions soulevées par les événements du 11 septembre… Le lendemain, il me propose de jouer un petit rôle dans son film. Il m’emmène sur la place du Dam, où la foire annuelle s’est installée, et nous montons dans la grande roue. Arrivé tout en haut, au point de vue le plus vertigineux, Declercq se met à filmer. En douce, avec une petite caméra digitale, à hauteur de hanche. Je suis Sibel Edmonds, agent secret, chargée de lui remettre une enveloppe et un petit carnet de notes noir. En même temps, il me faut l’entretenir du « Vigilant Guardian », du « Northern Guardian » et lui recommander la prudence : « Be careful ». Je ne sais pas trop à quoi rime mon rôle, ni quel est le sien, mais j’imagine que ces derniers mots ne sont pas laissés au hasard. Connaissant Declercq, il doit de nouveau travailler sur un sujet extrêmement sensible.
Vendredi 24 juin 2005, entre 11 et 16h
Rue Brulatour, chez Alain Declercq, Bordeaux
Tandis qu’il met la dernière main à son film dans un studio bordelais, Declercq reçoit la visite impromptue d’une délégation des brigades criminelles et antiterroristes françaises. Ils sont une quinzaine. Ils fouillent l’appartement qu’il occupe alors avec un ami journaliste, C.P. Les policiers trouvent un important matériel suspect : une notice sur Al Qaida, des armes factices, des billets d’avion, des photocopies de billets de 500 euros, un polaroïd de missile s’abattant sur le Pentagone, etc. Ils pensent être tombés sur une cellule secrète française d’Al Qaida, qui entretient même probablement des liens avec le réseau madrilène, et ouvrent illico une procédure judiciaire à l’encontre d’Alain Declercq. Au cours de leurs investigations, ils butent à plusieurs reprises sur un certain « Mike ». Cinq heures d’interrogatoire ne seront pas de trop pour tenter de percer qui est ce Mike, et quelles relations Declercq entretient avec cet étrange personnage, inconnu de leurs fichiers. Declercq essaie d’expliquer qu’il s’agit d’une œuvre d’art, que tout cela est fictif. Qu’il n’est pas un criminel ni un terroriste, et qu’il exerce même dans une branche qui aspire à s’adresser, ouvertement, à un public aussi large que possible… Declercq racontera : « Le problème c’est qu’à un moment, ils se sont mis à se demander si "artiste" n’était pas, justement, la meilleure et la plus rusée des couvertures – le moyen idéal de dissimuler des activités terroristes. À partir de là, évidemment, si on veut être probant, on a intérêt à bien s’accrocher. » Quand je lui demande si le dossier a été classé depuis, il laisse sa réponse en suspens. Sa maison, dit-il, serait toujours surveillée, et son téléphone sur écoute. Les colis qu’il envoie parviennent rarement à bon port. « Je n’ai vu que le sommet de l’iceberg, une quinzaine de policiers, un interrogatoire de cinq heures, un juge… mais je ne sais pas ce que cela cache ni ce qui s’annonce. »
Le même jour, entre 15h et 16h10
77 rue Lamarck, appartement de C.P., Paris
Quelques heures après ce débarquement de police, C.P., l’ami journaliste, est prévenu par téléphone que son appartement a été cambriolé. L’effraction a été commise entre 15h et 16h10. Un ordinateur portable et une caméra digitale ont disparu, alors qu’un lecteur DVD et un carnet de chèques qui traînait à vue sont restés à leur place. L’enquête officielle qui s’ensuit conclut à un manque de preuves d’un quelconque lien entre les deux événements.
La théorie élémentaire des complots vous l’apprendra : il n’y a pas de hasards. Dans cette façon d’envisager les choses, tout est lié. Il n’y a pas de faits simples ni de conséquences fortuites. Et tout a un sens. Voilà qui explique probablement le succès de cette logique (voyez le succès du livre Da Vinci Code, du Fahrenheit 9/11 de Michale Moore, ou du dernier film de Theo van Gogh, 0605, à propos de l’assassinat de Pim Fortuyn). Les théories du complot donnent un aperçu assez fidèle de la réalité. Des réseaux terroristes invisibles et fugitifs ? Des opérations douteuses ? Des informations cachées ? On en revient toujours à se demander à qui cela profite. Les puissants, les multinationales, les élites. On arrivera bien à prouver qu’il y a un méchant là-derrière, chaque détail, chaque anecdote et la moindre bribe d’information qui traîne finiront bien par en attester. C’est plutôt rassurant. Dans un monde qu’il est de plus en plus compliqué et difficile d’appréhender, la théorie des complots offre un schéma de compréhension simple, cohérent, donc séduisant.
Jeudi 15 septembre 2005, 18h
40 rue de Seine/ 2 rue de l’Échaudé, galerie Loevenbruck, Paris
Un bureau à peu près réglementaire trône au milieu de la pièce. Des papiers et des documents y sont étalés et suggèrent qu’un cambriolage ou une perquisition vient d’avoir lieu. Il est en tout cas manifeste que tout cela a été scrupuleusement inspecté. Les documents sont étalés comme pour être photographiés. Au mur sont alignés des photos des locaux gouvernementaux américains, des photos d’avions, un porte-documents à double fond avec sa paperasse, et un feuillet encadré portant ces mots : « By pen and gun, by word and bullet, by tongue and teeth ». En face du bureau, un escalier mène au sous-sol. Là, dans une petite salle, on projette Mike, le dernier film d’Alain Declercq, tant attendu, et dont c’est l’avant-première.
Le film est fait d’images à la dérobade, montées comme un ensemble de rushes. La première partie se déroule quelque part au Moyen-Orient. Un groupe d’hommes s’agenouille en pleine rue, l’appel à la prière musulmane retentit par-dessus les toits, une Jeep fend le désert et traverse un camp de soldats. Nous voilà ensuite à Washington : des hommes en costume sombre s’affairent autour d’hôtels luxueux, et des voitures diplomatiques glissent en rond au pied du Pentagone. Le film regorge de signes de reconnaissance dont la charge et la puissance suggestive s’affirment peu à peu. La dernière partie nous ramène en Europe : la foire à Amsterdam, un quartier de bureaux parisien, une base militaire américaine au sud de l’Angleterre. Tout est filmé par une seule et même personne, Mike, qui se dit agent de renseignements. De temps en temps il apparaît à l’écran et raconte ce qu’il a vu et entendu ce jour-là. Mais presque tout ce que Mike peut observer semble le conduire à une impasse. Du coup, bien des choses demeurent sans explication. En même temps, m’apprend Declercq, le film renferme d’abondantes informations codées. Quasi chaque plan, chaque nom, chaque nom de code s’inspire de théories et de faits réels. Le film est un mélange de démonstrations et de spéculations qui sème la confusion. Mike est-il un agent secret, ou peut-être un terroriste ?… Où est la réalité, où est la fiction ?
Ce qui est sûr, c’est qu’Alain Declercq, à travers ce film, indique combien il est facile d’attiser l’angoisse et la méfiance par les temps qui courent. Et ce qui est encore plus sûr, c’est qu’il a pu mesurer, à son corps défendant, les conséquences de ses petites pérégrinations sur des sables politiquement mouvants. Mais n’oublions pas que l’artiste a produit une fiction. Il ne s’est pas laissé aspirer par la tendance à la paranoïa, ni par l’idée fixe que des forces obscures dirigeaient nos vies. Son état est sain : il est capable de douter de son propre doute. Son imagination lui donne la possibilité de raconter, à partir de faits authentiques, une histoire parallèle, d’aiguiller la réalité vers une alternative. Et il montre par là le potentiel critique et créatif dont la théorie des complots peut, elle aussi, se révéler porteuse.
Nina Folkersma est critique d’art et commissaire d’xpositions.